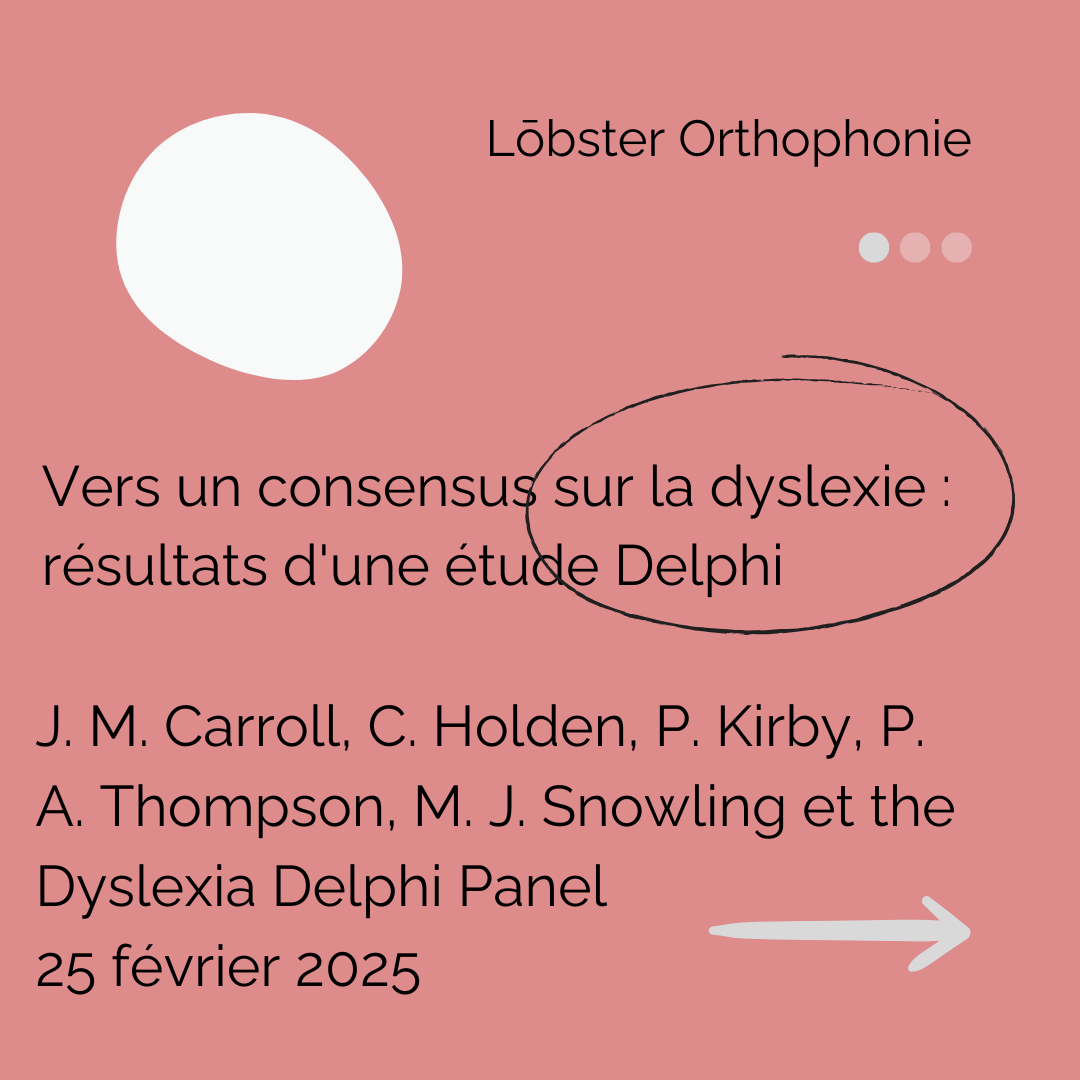Titre de l’article : Vers un consensus sur la dyslexie : résultats d’une étude Delphi
Auteurs : J. M. Carroll, C. Holden, P. Kirby, P. A. Thompson, M. J. Snowling et the Dyslexia Delphi Panel
Date de parution : 25 février 2025
Résumé en quelques mots
La traduction de l’article est libre. Certains passages sont repris plus ou moins littéralement, d’autres retraduits pour faciliter la lecture.
Cet article fait suite au très récent consensus Delphi et propose une définition de la dyslexie pour évaluer, identifier et conduire une politique éducative.
Rappel historique : le terme de “dyslexie” a été inventé par l’ophtalmologue allemand Rudolf Berlin dans les années 1880. La définition a varié au fil des ans, impliquant les troubles phonologiques, puis la notion de conditions d’apprentissage classiques et de concordance avec le niveau intellectuel. Depuis les années 2010, le terme de dyslexie est fréquemment évité (cf le DSM-V : “trouble spécifique des apprentissages en lecture”).
La problématique est double : d’un côté la co-occurrence fréquentes d’autres troubles mais aussi de l’évolution des habilités en fonction des stades de développement et d’un autre côté le rôle des interventions et du soutien. La question essentielle que je suis heureuse de voir posée noir sur blanc, a fortiori quand on accompagne des enfants HPI ayant ces troubles des apprentissages, c’est : comment intégrer des enfants qui, bénéficiant d’intervention adaptée, s’améliorent, et alors ne rentrent plus dans une définition basée uniquement sur le niveau de réussite, alors même que parents et expérience clinique suggèrent que priver ces enfants d’intervention leur fait prendre du retard par rapport à leurs pairs (Thompson, 2021).
Le consensus Delphi
Le consensus est né au Royaume Uni de la volonté de faire rejoindre les débats de chercheur·euses, les points de vue de clinicien·nes et de personnes expérimentant la dyslexie.
L’étude Delphi a ainsi étudié les bonnes pratiques en matière d’évaluation de la dyslexie et proposé une définition et les critères d’identification.
Inspiré de Catalise pour le langage oral (2017), Delphi se base sur des tours itératifs soumettant 42 affirmations à des spécialistes et des personnes dyslexiques de plusieurs pays dans 5 domaines :
- La nature de la dyslexie
- Les expériences de la dyslexie
- Pourquoi et quand évaluer
- Quoi évaluer
- Les critères d’identification
Les déclarations ont été acceptées à 80% ou retestées après modifications/reformulations.
1. Définition de la dyslexie
Le niveau d’attente est fonction de l’âge mais aussi de l’exposition à l’enseignement, la qualité de l’éducation, le niveau atteint dans d’autres domaines.
Les idées retenues par le consensus sont
– la persistance imprévue des troubles
– la notion de fluidité verbale, même si elle n’est pas un marqueur
– le manque de maîtrise de la lecture (entendue comme lecture précise et automatique) est un marqueur fiable
Priorité est donc donnée à la maîtrise de la lecture et de l’orthographe même si certains aspects du déchiffrage peuvent être dans la moyenne. Ainsi, le profil des adultes très performants, ayant bénéficié d’un soutien important dans leur apprentissage, peuvent confirmer un profil de dyslexie.
2. Habilités intellectuelles et dyslexie
Le consensus propose de parler de trouble apparaissant dans tous les rangs de l’intelligence et de sévérité en fonction de la réponse à l’intervention. Il précise :
– toutes les personnes ayant des difficultés de lecture doivent pouvoir bénéficier d’une intervention ciblée et suivie (quel que soit leur niveau d’intelligence)
– lorsqu’une personne a des difficultés générales d’apprentissages (déficience intellectuelle), appliquer une étiquette de dyslexie peut engendrer une approche trop étroite du suivi
– L’écart entre la capacité intellectuelle et le niveau d’alphabétisation est un indicateur d’une difficulté d’apprentissage spécifique mais non suffisant pour le diagnostic
3. Etiologie de la dyslexie
Les causes étiologiques de la dyslexie ne figurent pas en définition mais le panel se prononce en la faveur de multiples causes impliquées dans la dyslexie. Les déclarations mettent ainsi en garde contre l’idée d’un seul facteur étiologique :
- Les antécédents de dyslexie dans la famille sont un facteur de risque de la dyslexie. Cependant, il existe des facteurs multiples génétiques et environnementaux
- Attribuer la dyslexie à une faiblesse phonologique ou des problèmes de mémoire de travail ne tient pas compte de la variabilité individuelle ou de la nature fortement imbriquée de la dyslexie avec d’autres troubles des apprentissages
Il est capital de retenir que le trouble le plus commun observé est la difficulté de traitement phonologique (conscience phonologique, vitesse de traitement phonologique, mémoire phonologique), preuve plus robuste que les autres facteurs tels que l’attention visuelle, les processus visuels ou les compétences orthographiques.
– Le plus gros marqueur de la dyslexie est la conscience phonologique, définie comme l’habilité à réfléchir et manipuler sur la structure sonore des mots.
– Le deuxième est la mémoire phonologique qui réfère à la mise en mémoire à court terme des informations verbales (non mots, mots ou chiffres).
– Le troisième marqueur est la dénomination rapide automatique DRA de symboles familiers, de dessins ou de couleurs, considérée comme une mesure de la vitesse de traitement phonologique (et pour certains comme une mesure de la récupération en série de codes lexicaux en réponse à des informations visuelles, comme le fait la lecture).
Par ailleurs, l’orthographe (capacité à former et récupérer des lettres, des séquences de lettres et d’épeler des patterns de lettres) est généralement touchée mais elle pourrait être un marqueur lié à la difficulté phonologique ou d’alphabétisation et non à la dyslexie.
4. Co-occurerence d’autres troubles
Il y a une fréquente co-occurrence entre la dyslexie et d’autres troubles neuro-développementaux comme le TDL, le TDAH, le trouble de la coordination et la dyscalculie. Des recherches sont nécessaires pour comprendre les facteurs de risque spécifiques communs et spécifiques qui expliqueraient cette co-occurrence.
5. Impact changeant de la dyslexie au cours de la vie (perspective life-span)
La dyslexie persiste jusqu’à l’adolescence et a un impact sur la lecture jusqu’à l’âge adulte. Mais :
- De multiples facteurs influencent l’impact et la trajectoire de la dyslexie. Ses manifestations peuvent changer tout au long de la vie en fonction du contexte
- La mémoire de travail, la vitesse de traitement et les habilités orthographiques peuvent contribuer à l’impact de la dyslexie
- Après intervention, la lecture et les difficultés associées chez les individus dyslexiques peuvent ne plus être vécues comme un handicap bien que ce soit toujours des challenges
- Les facteurs de protection de la dyslexie incluent une intervention précoce et soutenue et de bonnes habilités en langage oral, verbal et non-verbal
La puissance de ce consensus est d’offrir une perception dynamique de la dyslexie qui nécessite une perspective développementale pour comprendre son impact.
De fait, les stratégies de compensation sont bien reconnues : la dyslexie peut affecter ++ la compréhension du langage écrit, ou au contraire être une stratégie de compensation grâce au niveau de langage de l’enfant.
6. Les idées reçues courantes
Retenons parmi les idées reçues passées au crible qu’il n’y a pas de preuve diagnostique sur la latéralité (plus de non-droitiers mais pas de preuves de causalité).
Autre idée intéressante (ahhhh !), il n’y a pas de preuves permettant d’affirmer que la dyslexie développe des trésors d’ingéniosité ou de créativité…
Définition de la dyslexie selon Delphi
La dyslexie est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par un trouble de la lecture hautement héréditaire et souvent inattendu au regard des autres habilités cognitives. L’accent est mis sur l’aspect multifactoriel et la persistance du trouble tout au long du développement malgré les changements de manifestations.
Les principaux facteurs de risque dont il est essentiel de tenir compte explicitement sont les antécédents familiaux de dyslexie, la pauvreté du langage, les difficultés phonologiques et la persistance des difficultés malgré l’intervention.
Trois assertions majeures ressortent de cette définition :
- Les difficultés en lecture et en orthographe sont liées à l’âge, aux capacités et aux attentes éducatives.
- Un rôle causal est reconnu pour le traitement phonologique mais d’autres facteurs jouent un rôle dans la variabilité individuelle.
- Il existe un fort taux de co-occurrence avec d’autres troubles, pas seulement en termes de diagnostic différentiel mais de traits subcliniques des troubles.
La difficulté persistante à maîtriser la lecture est évidemment une clé de compréhension de la dyslexie. Mais il est fondamental d’intégrer que l’étude des facteurs influant sur la dyslexie (faiblesse en traitement phonologique dont la DRA, faiblesse de décodage, niveau de langage oral et le risque familial) est plus fiable que l’écart à la norme en termes de réussite (seuil de réussite), en termes de niveau intellectuel (écart au QI) ou de déficit unique. En d’autres termes, les écarts-types ne disent pas tout…
D’autre part, la réponse médiocre au traitement participe alors à la compréhension du trouble dans une logique de “risque cumulé”. Il pourrait donc être intéressant de mettre en place un design d’évaluation comprenant d’abord une phase d’intervention puis une évaluation tenant compte de l’aspect développemental mais aussi de l’âge et du stade du·a patient·e. Le consensus préconise ainsi
– l’attribution de risque (ou de risque nul) pour les enfants, au sein d’un système de soutien et de dépistage systématique précoce
– une intervention puis, en fonction de la médiocrité des progrès, une évaluation
Les premiers prédicteurs sont la connaissance des lettres, la conscience des phonèmes, la DRA, et plus tard dans le développement, il est préconisé un test direct des processus de lecture, du langage et des processus de compréhension.
Il est intéressant de lire en ouverture d’article qu’il n’a pas pris en compte l’impact psychosocial de la dyslexie : impact sur la motivation, l’estime de soi et le bien-être émotionnel.
Pourquoi c’est important
La dyslexie est bien reconnue dans son continuum, ce qui est un point capital. Il y avait la question de degré de sévérité. Il y avait la question du degré d’impact fonctionnel. Intervient la notion de répercussions différentes en fonction des âges de la vie et ça, c’est vraiment cadeau.
Cet article est important aussi parce qu’il pose les bases de l’autre article sur le consensus (à suivre en prochain billet #Expertise !) qui lui, recontoure l’évaluation de la dyslexie. Il dit clairement que le critère de réussite ou d’échec doit être mis en balance non seulement avec la norme, mais aussi avec les performances individuelles dans les autres domaines. Que la réussite ou l’échec n’est que l’un des marqueurs dont le plus important reste la fluidité en lecture.
Ce que ça change
Les critères d’observation vont forcément se déplacer suite à ce consensus.
D’une part, il clarifie l’intrication entre les troubles de la lecture et ses répercussions sur les autres domaines d’apprentissage tels que l’orthographe, les mathématiques ou encore l’acquisition d’une langue étrangère.
D’autre part, il flèche notre regard sur les marqueurs les plus spécifiques à savoir :
– la difficulté de traitement phonologique entendu comme 1. la conscience phonologique, 2. la mémoire phonologique et 3. la vitesse de traitement phonologique (DRA)
– la faiblesse de décodage
– le niveau de langage oral
– le risque familial
Par ailleurs, l’explicitation de la modification de l’impact de la dyslexie aux différents âges de la vie va nous mettre en mouvement pour repenser nos interventions.
D’un côté, comprendre le continuum ne signifie pas que je doive réviser mes objectifs à la baisse (de “normalisation” à “amélioration”). Non, en fonction des variabilités individuelles, des réactions au traitement, de la vitesse de traitement, du niveau de langage oral, des facteurs environnementaux, un·e patient·e peut tout à fait régulariser ses performances en lecture mais c’est bien la notion de challenge, de défi qu’il conviendra d’intégrer et donc l’utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
D’un autre côté, le curseur se déplace à mesure que l’on dézoome de nos feuilles de passation et que l’on considère la perspective life-span : dois-je privilégier l’objectif plaisir de lire ou maintenir le déchiffrement à tout prix ?
Concrètement
– Le curseur est placé sur les facteurs de risque tels que les difficultés phonologiques et pas seulement la métaphonologie. Je comprends que les troubles du langage oral sont non seulement co-occurrents mais également actifs sur le pronostic.
J’entends l’importance de déployer le lexique, la flexibilité lexicale et la ressource en langage oral.
– Je comprends que mon·a patient·e bien compensé·e, fort·e cognitivement, bien accompagné·e, puisse subir un impact moins fort aujourd’hui (plus de réussite) ET avoir besoin d’accompagnement pour ne pas subir de retard par rapport aux autres. Je valorise le profil cognitif fort, à la grande vitesse de traitement, aux bonnes capacités de mémorisation et aux grandes habilités en langage oral qui permet de faciliter la compensation et donc d’amoindrir l’impact du trouble du langage écrit. Je m’appuie sur ce profil pour proposer un accompagnement adapté aux patient·es qui formulent la demande d’aide à cause du coût des compensations.
– Je comprends que l’impact peut changer à l’âge adulte et que si “dyslexie = trouble développemental = pour toute la vie”,la répercussion du trouble n’est pas une fatalité ni une évidence égale pour tous. La trajectoire de vie compte, et ce, pendant toute la vie.
Lien vers l’article complet : https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.14123
👉 Pour aller plus loin sur ce consensus, guettez l’article #Expertise – Billet 14 à venir à propos du deuxième article extrait de ce consensus.
👉 Pour aller plus loin sur l’intégration des temps en rééducation, voir les posts d’avril 2025 sur @orthophonieapp
#Expertise #Dyslexie #LangageEcrit #Bilan #Evaluation #Thérapie #Lifespan
#2025
#LobsterOrthophonie #Orthophonie