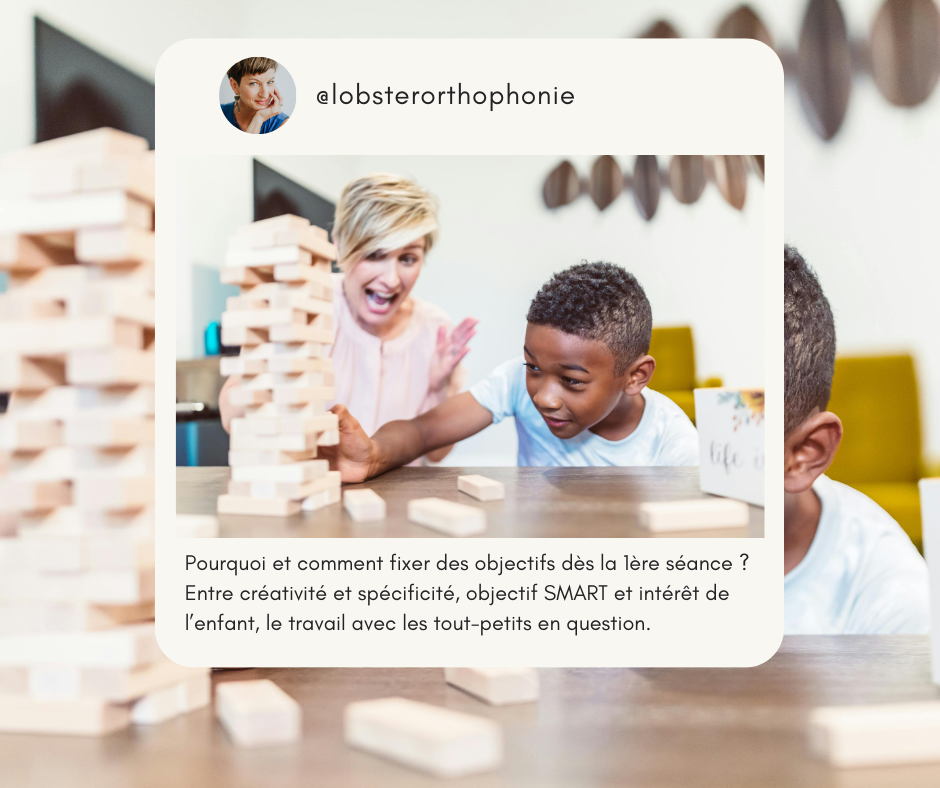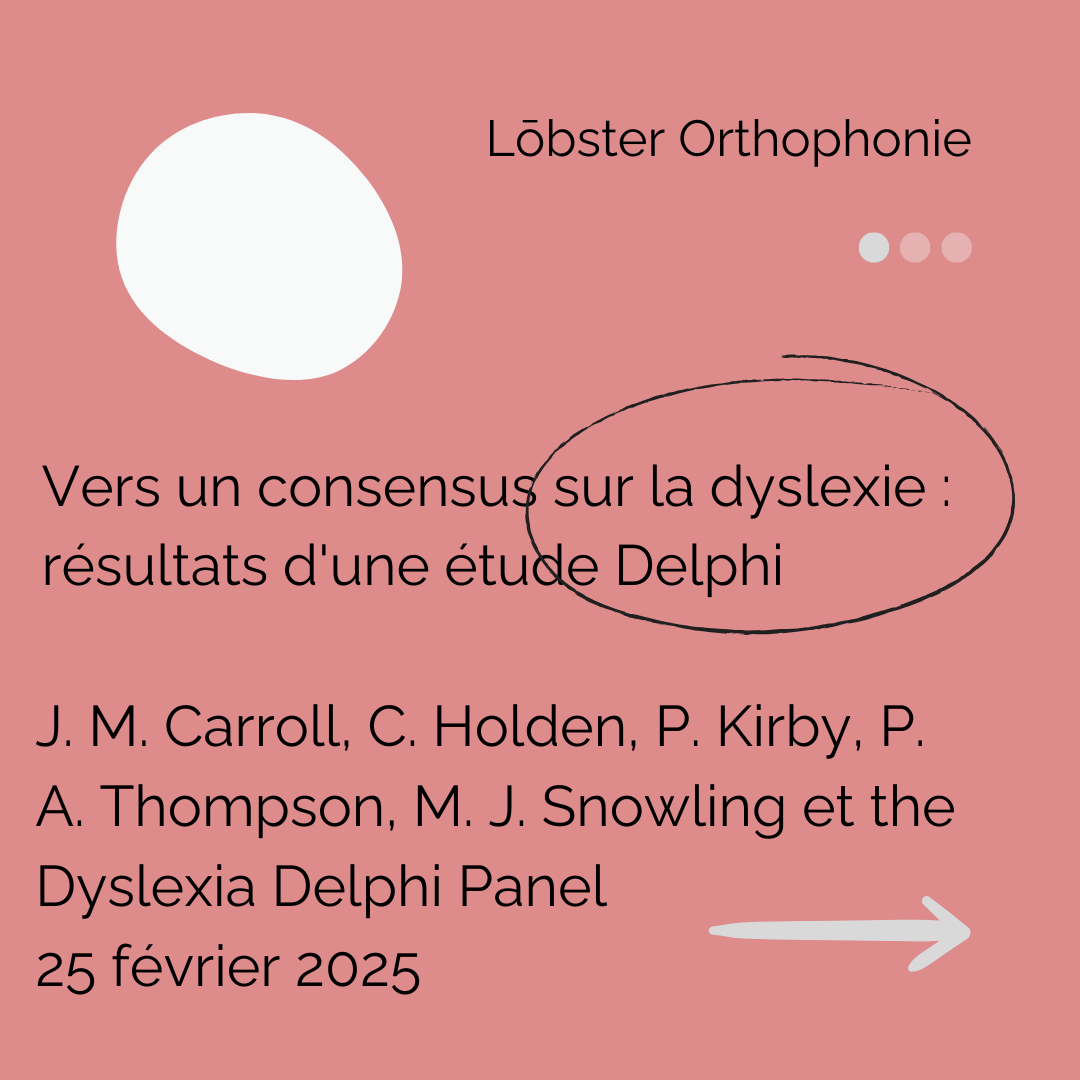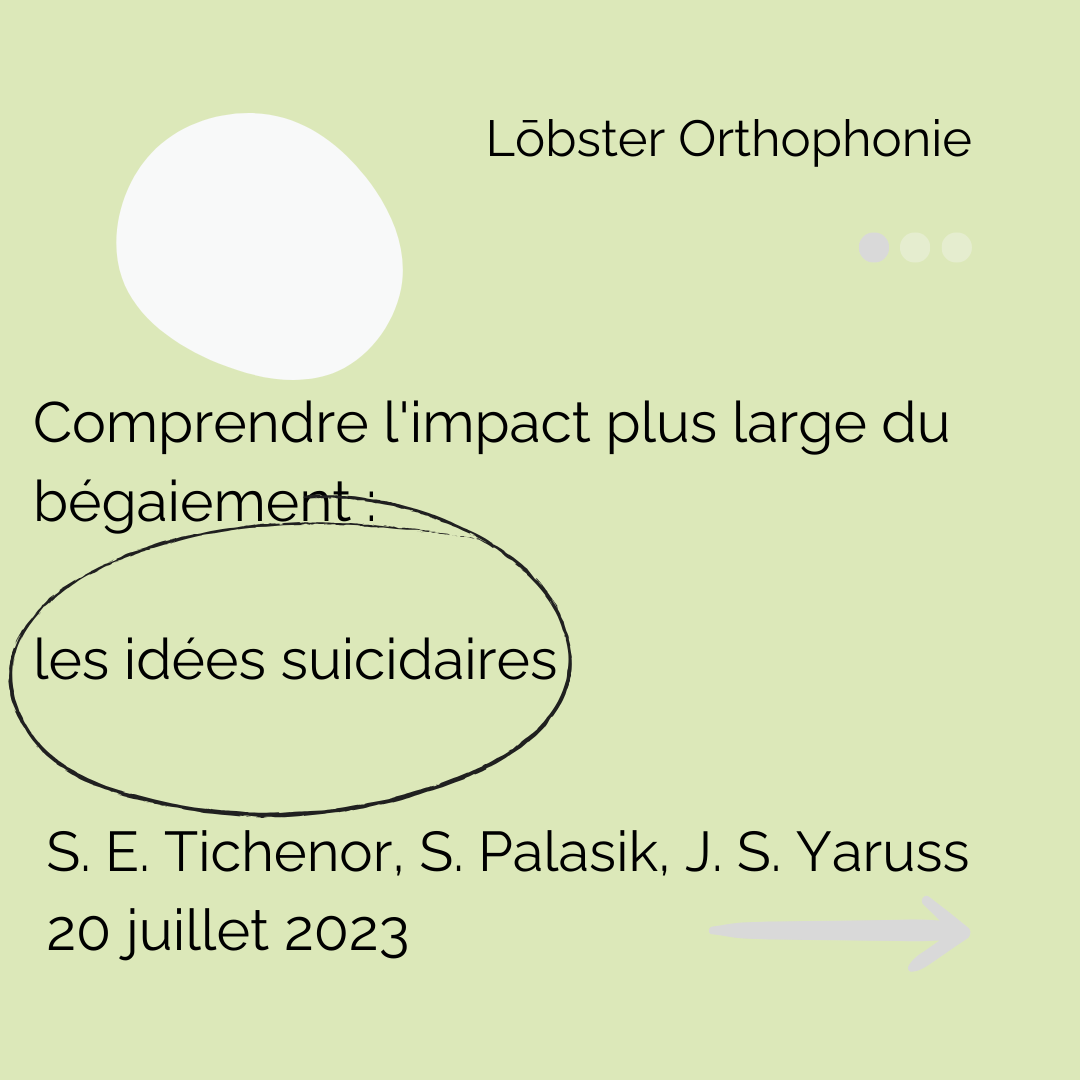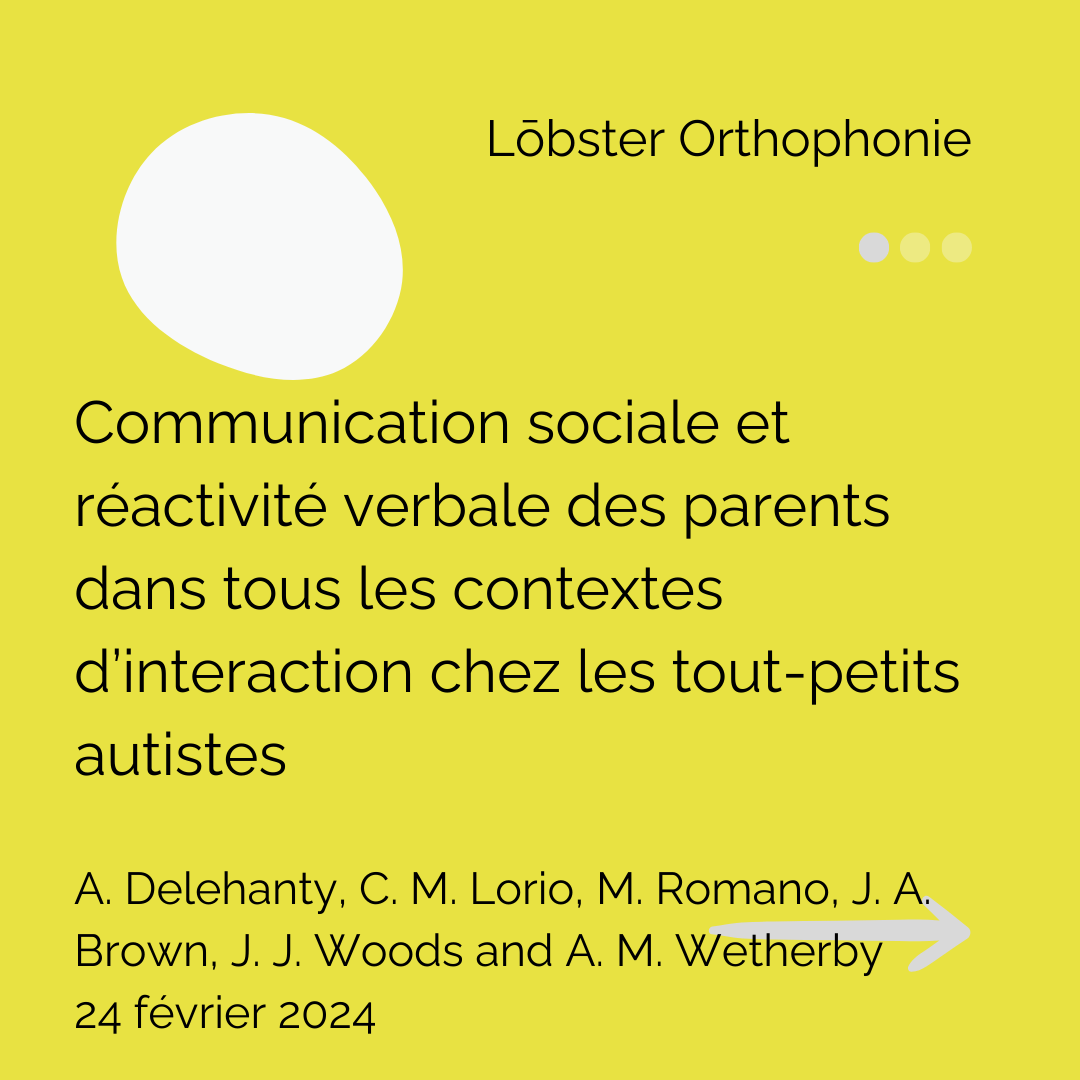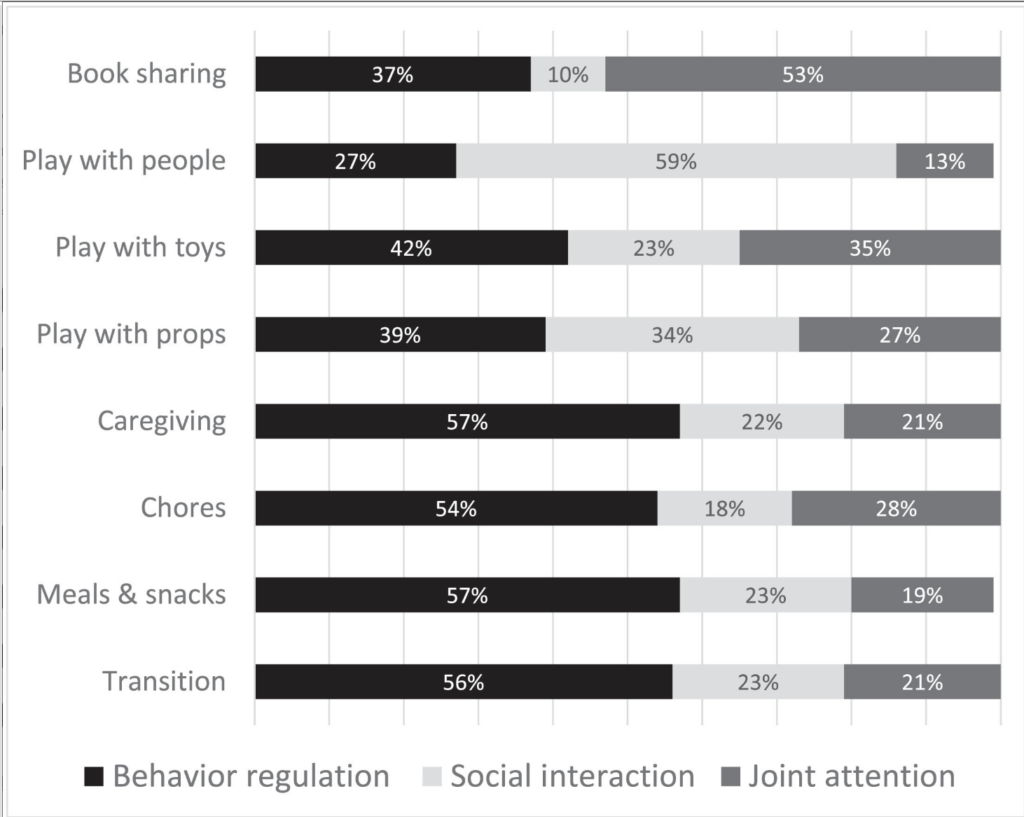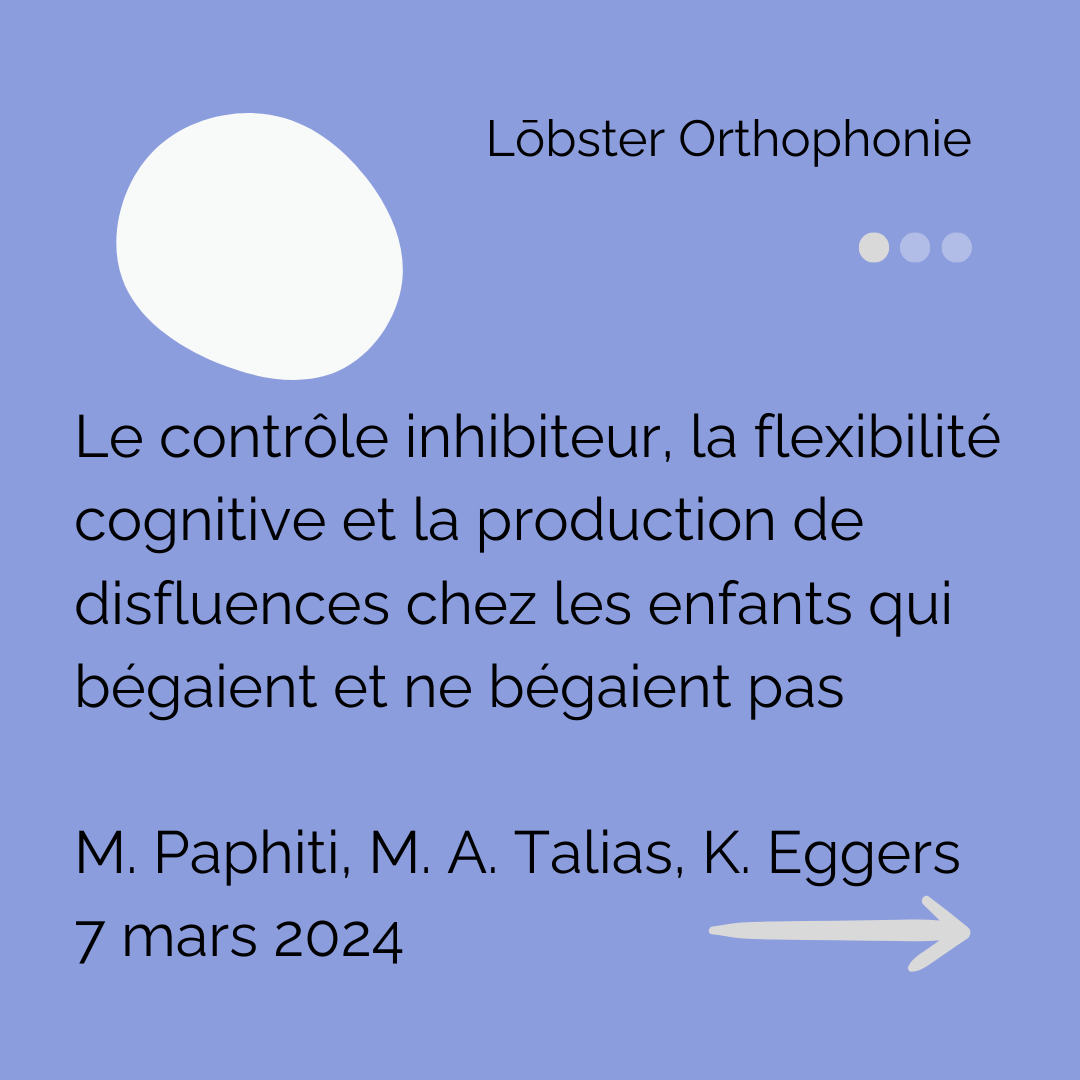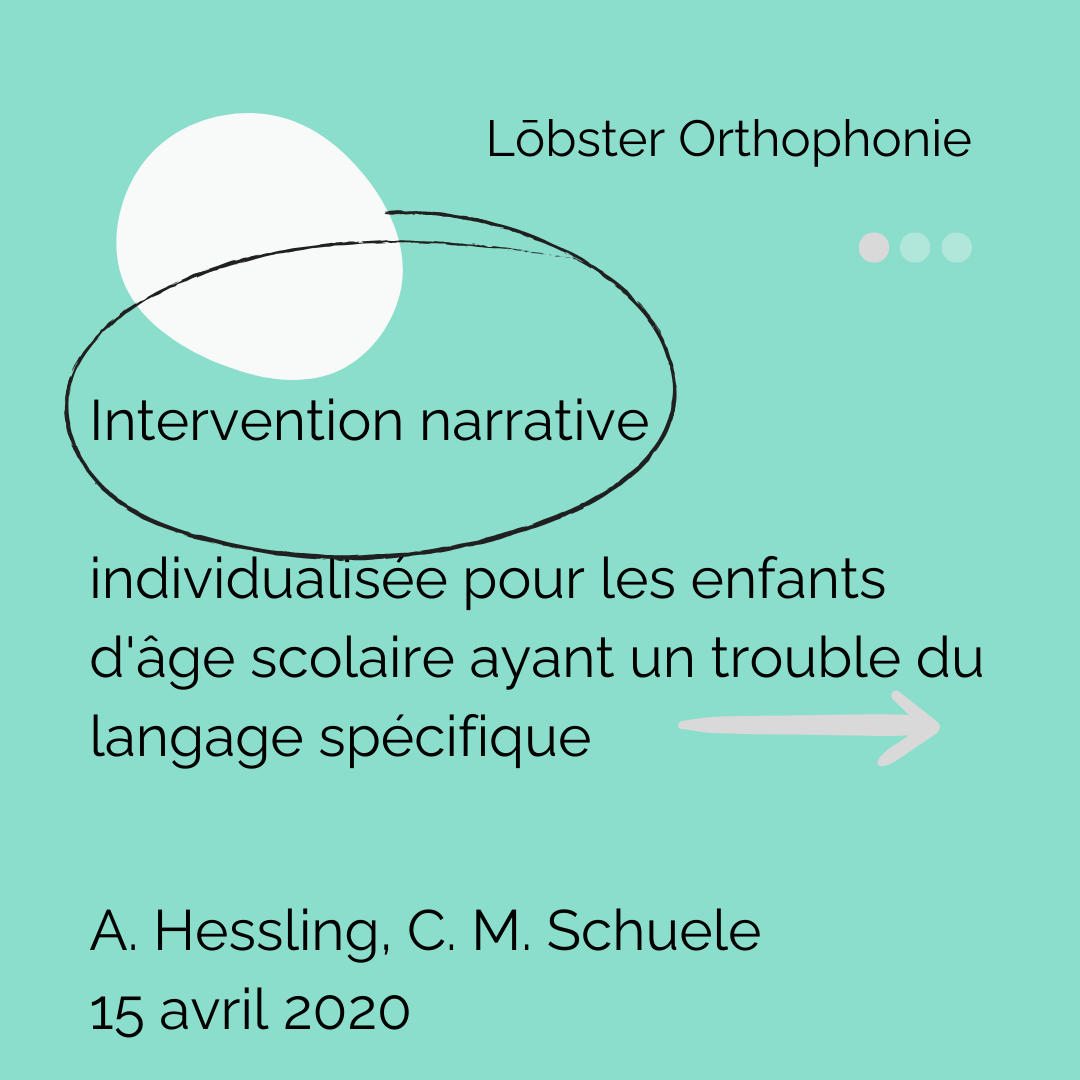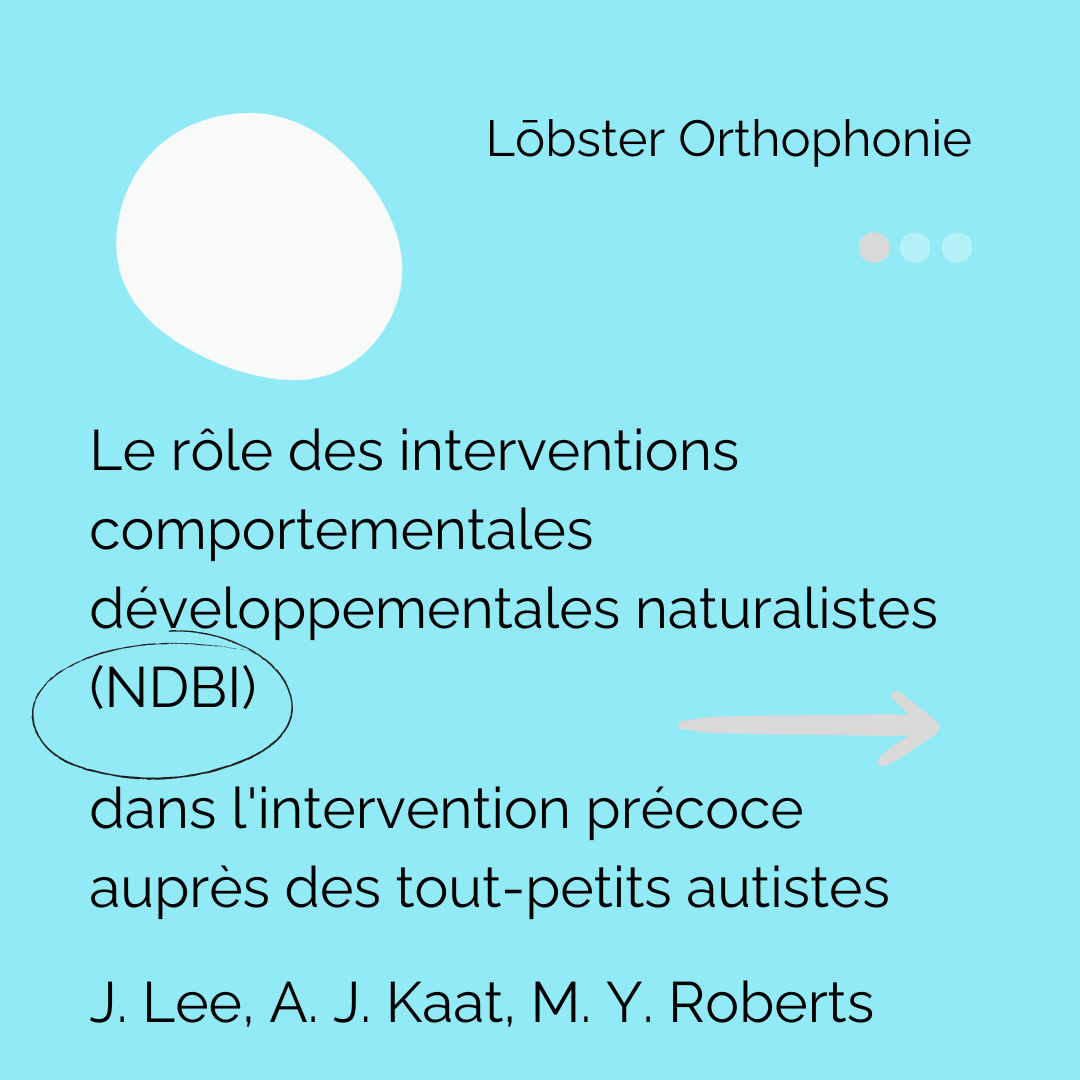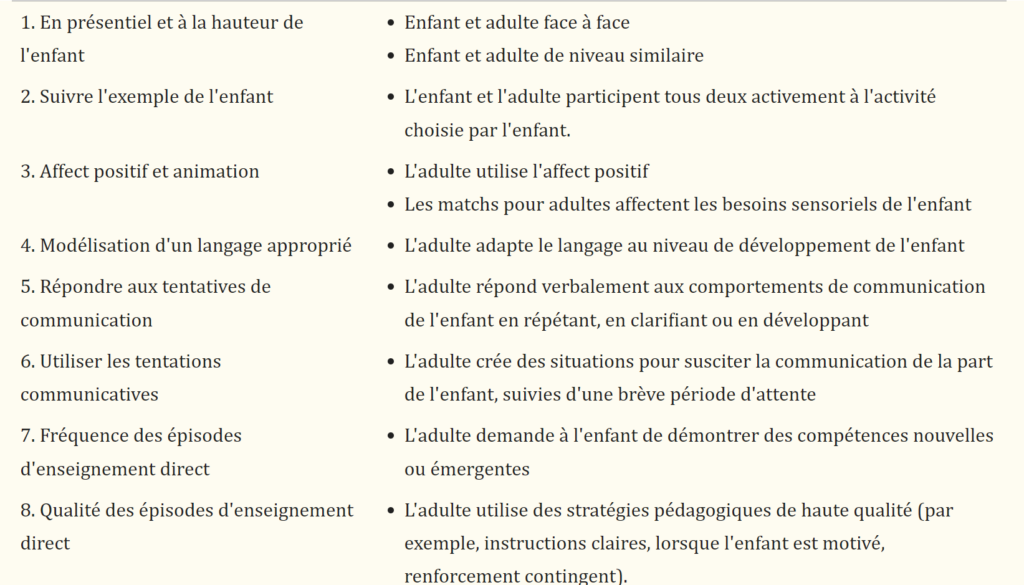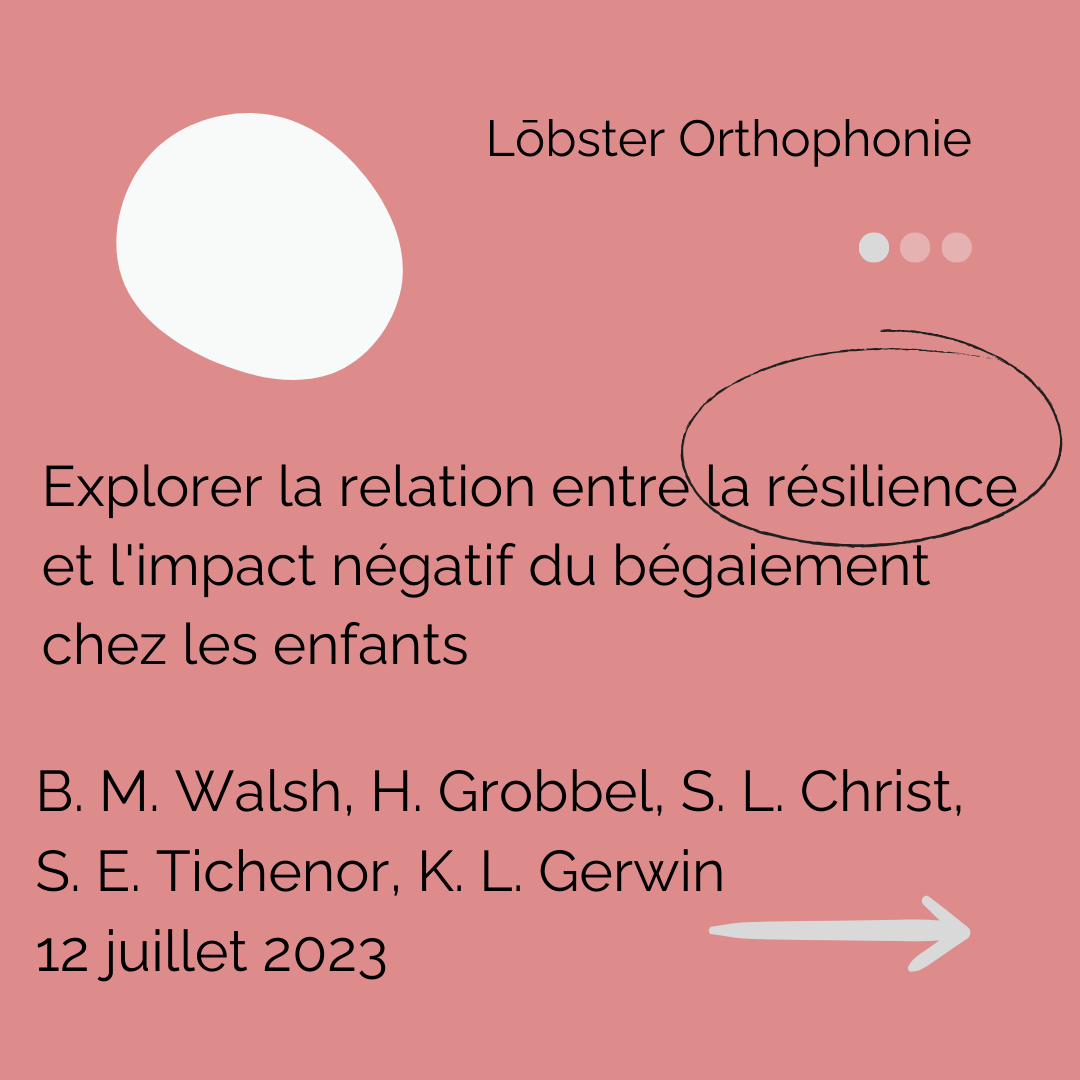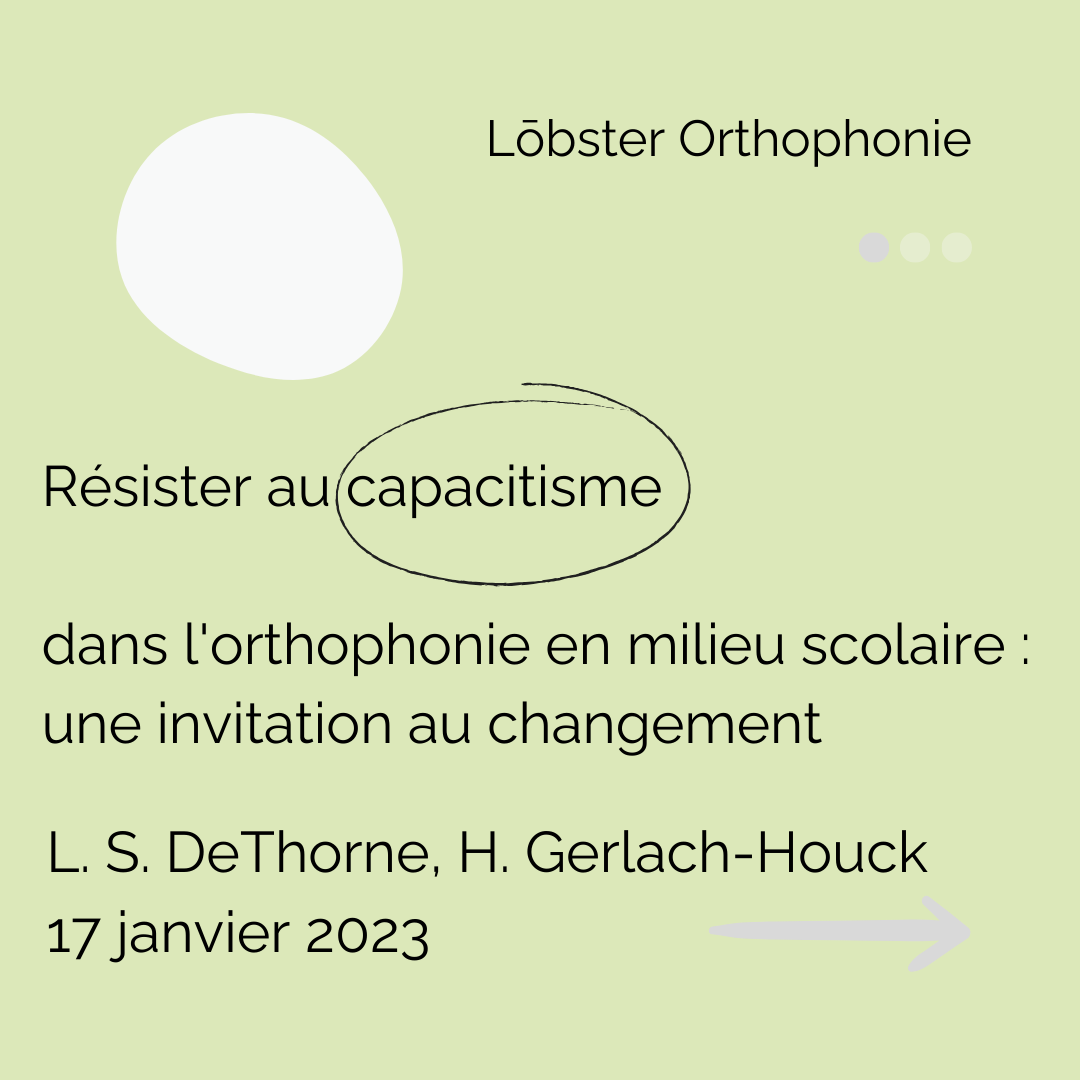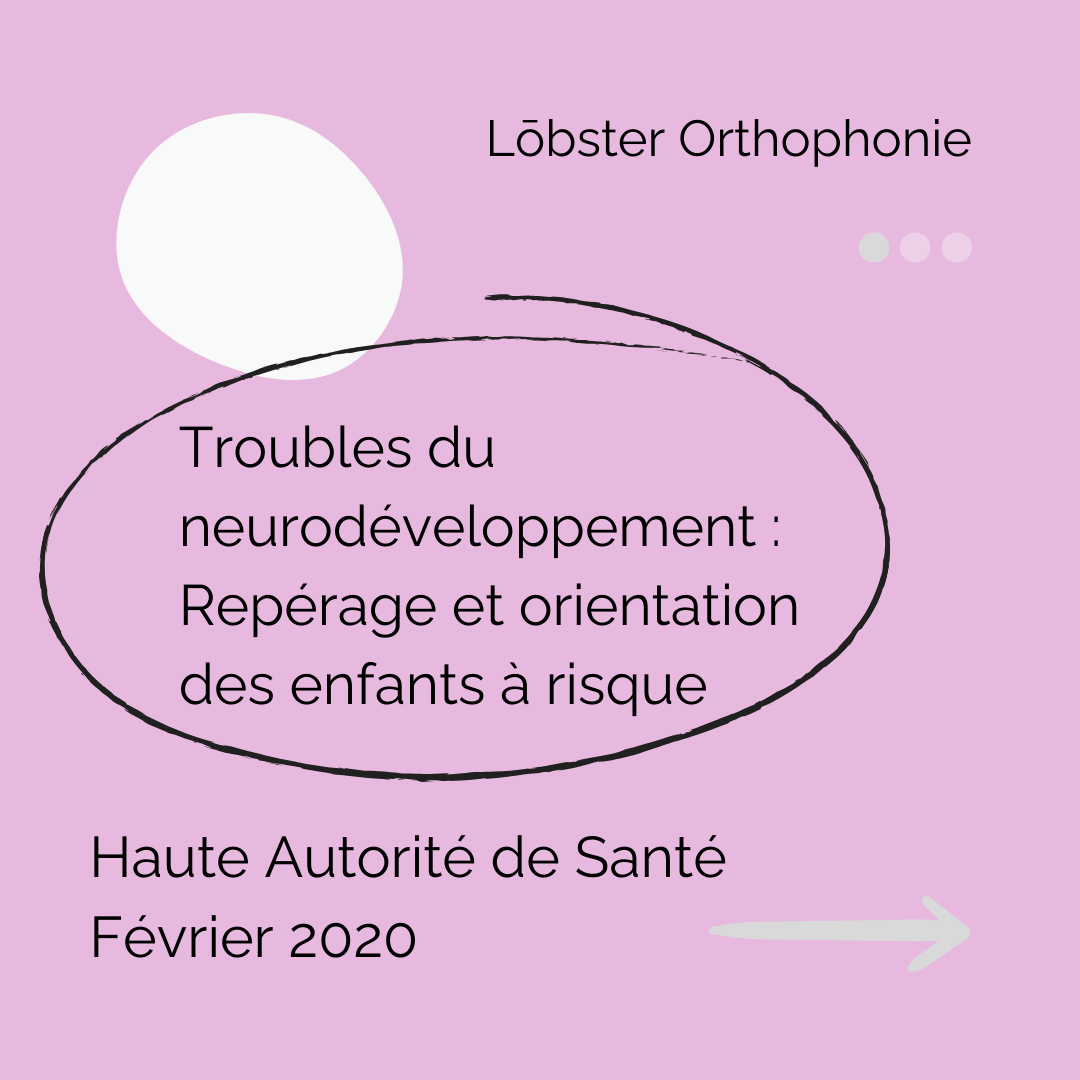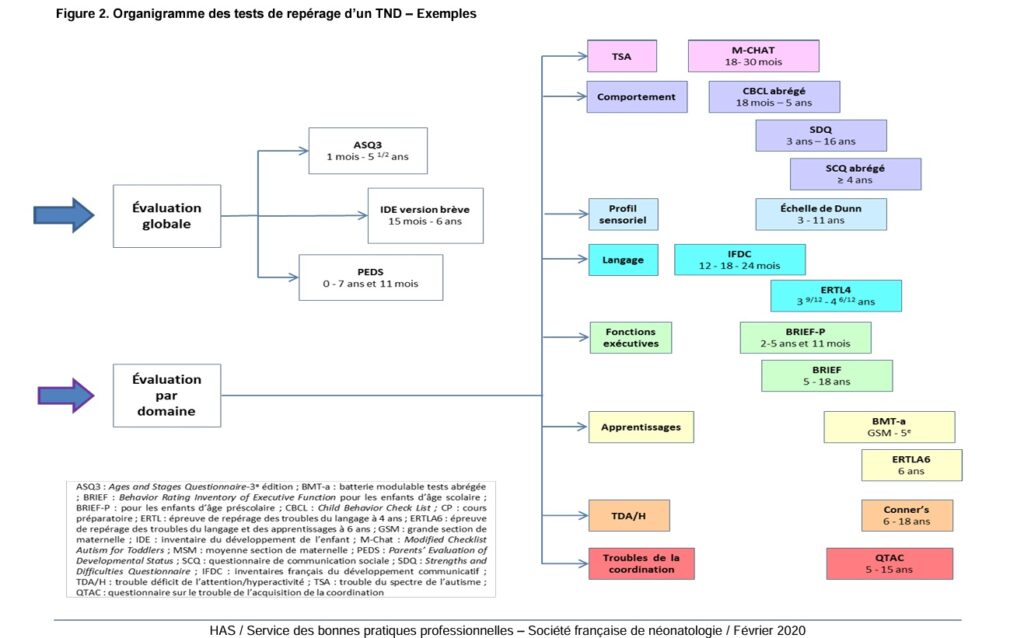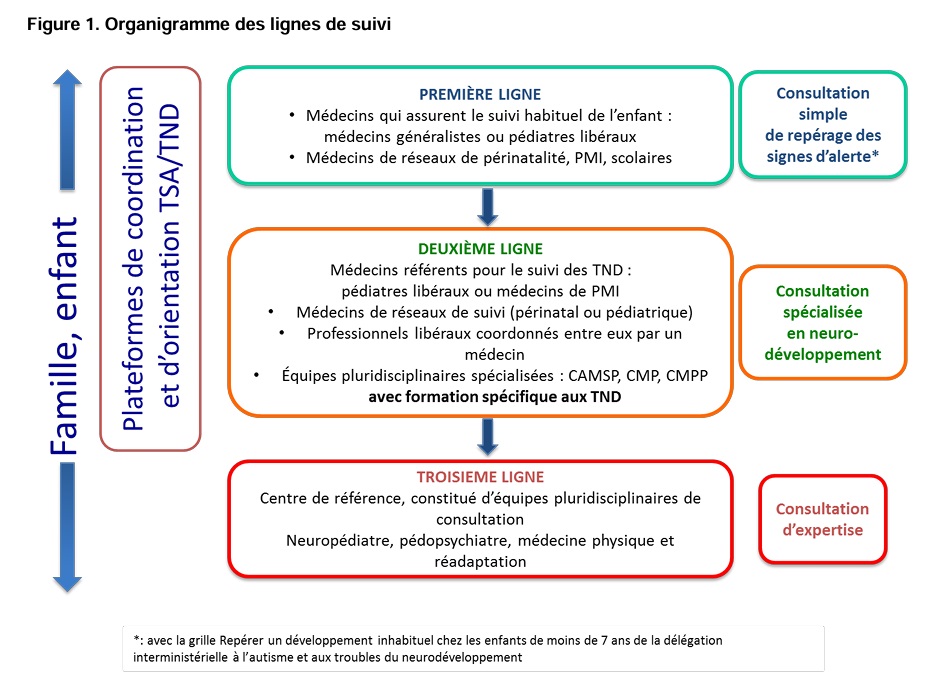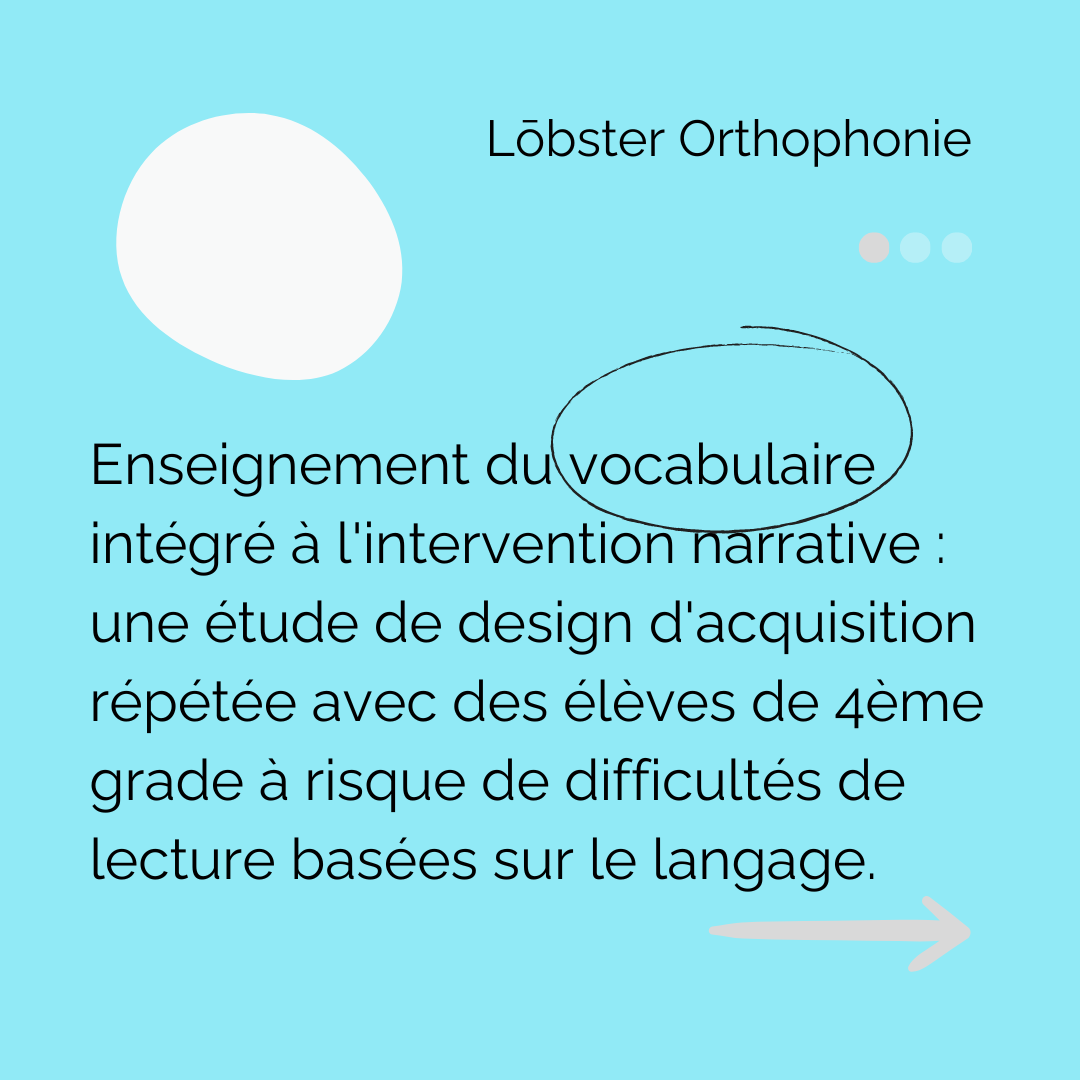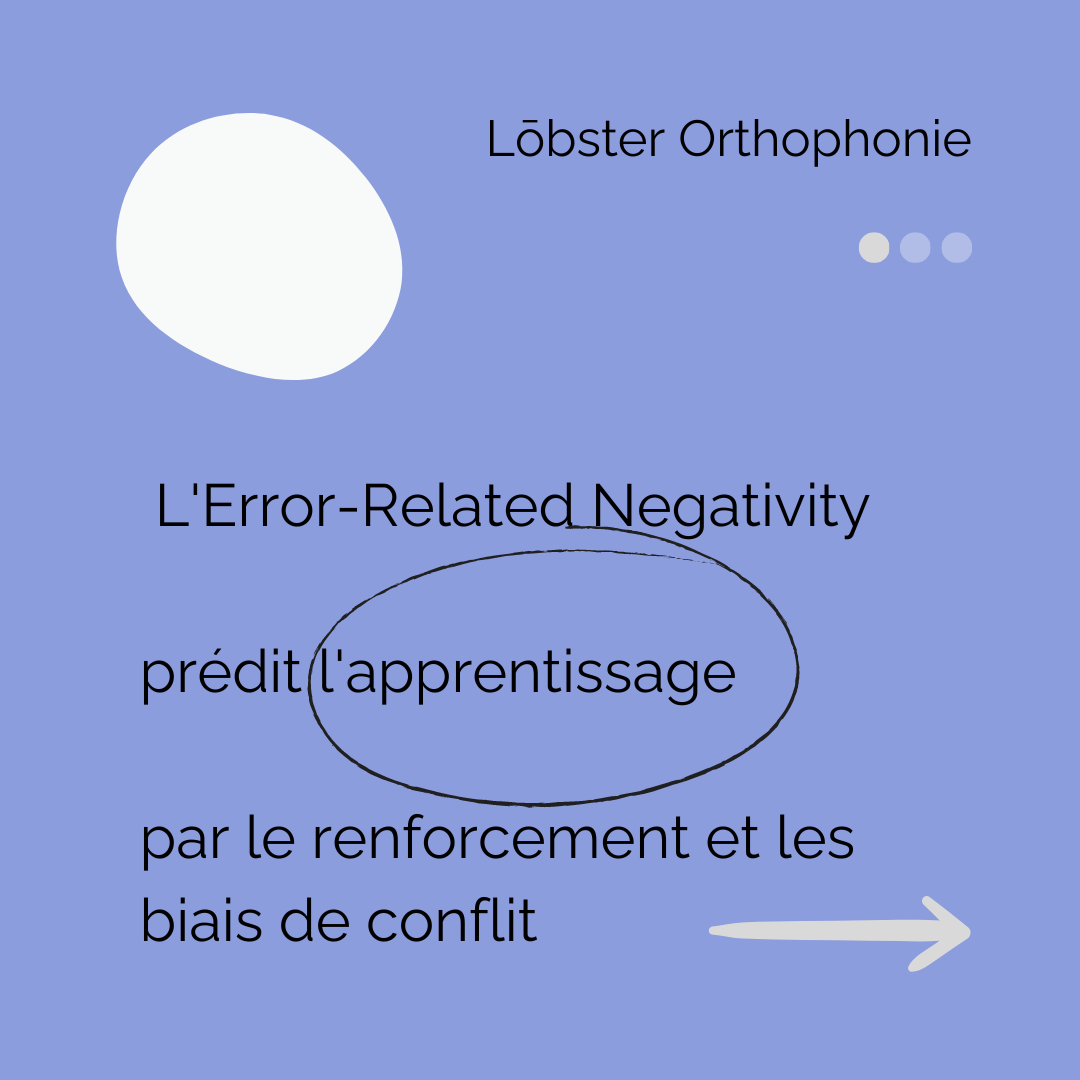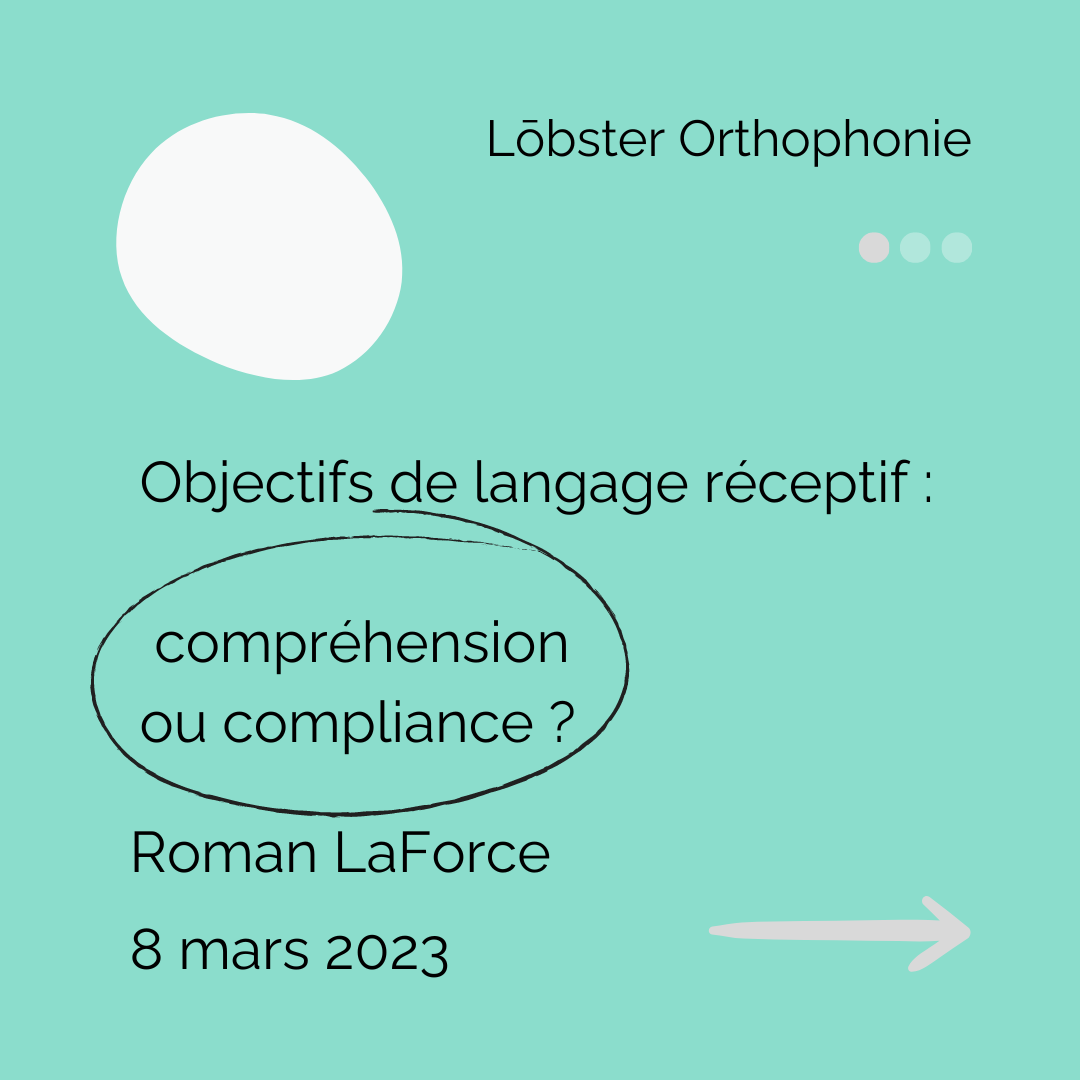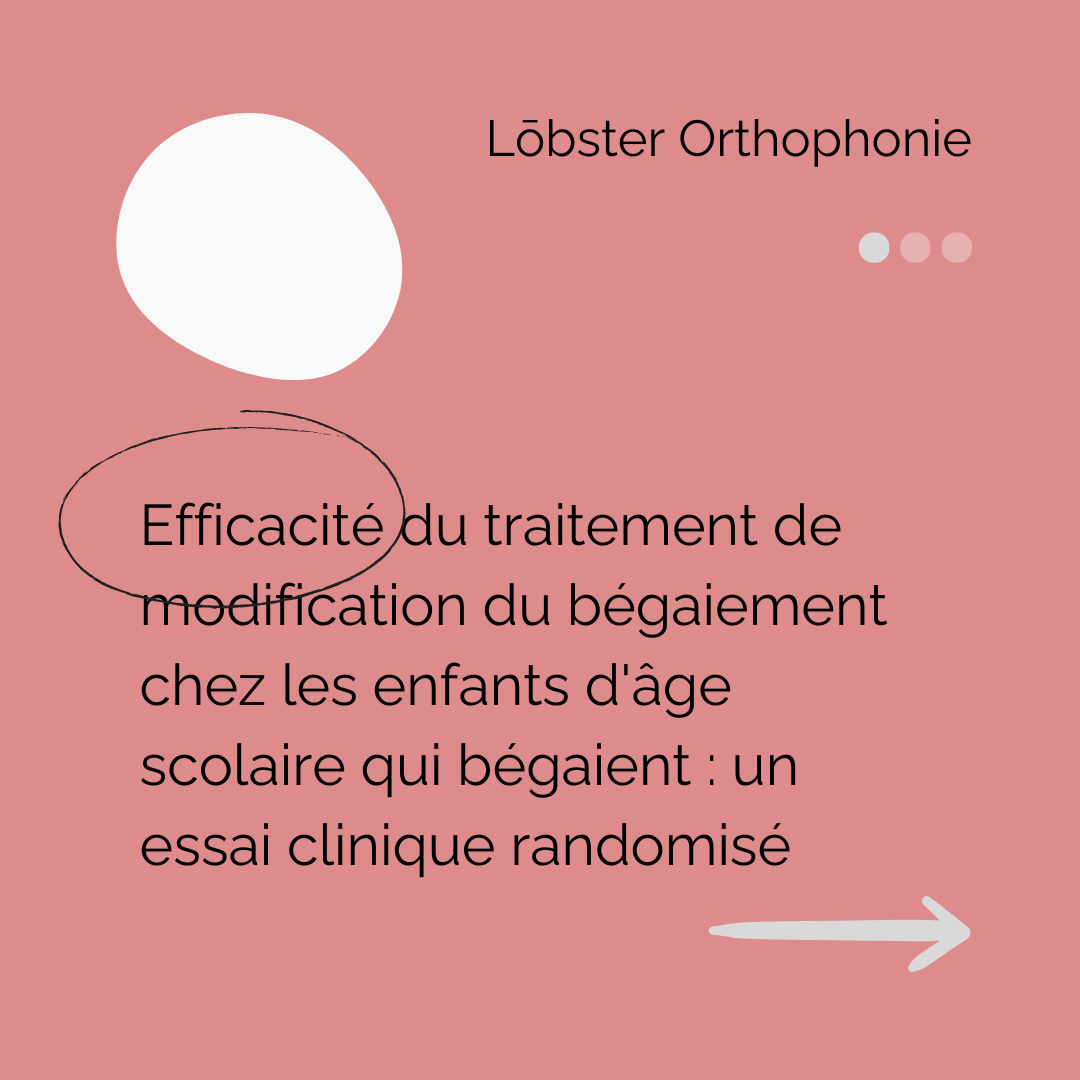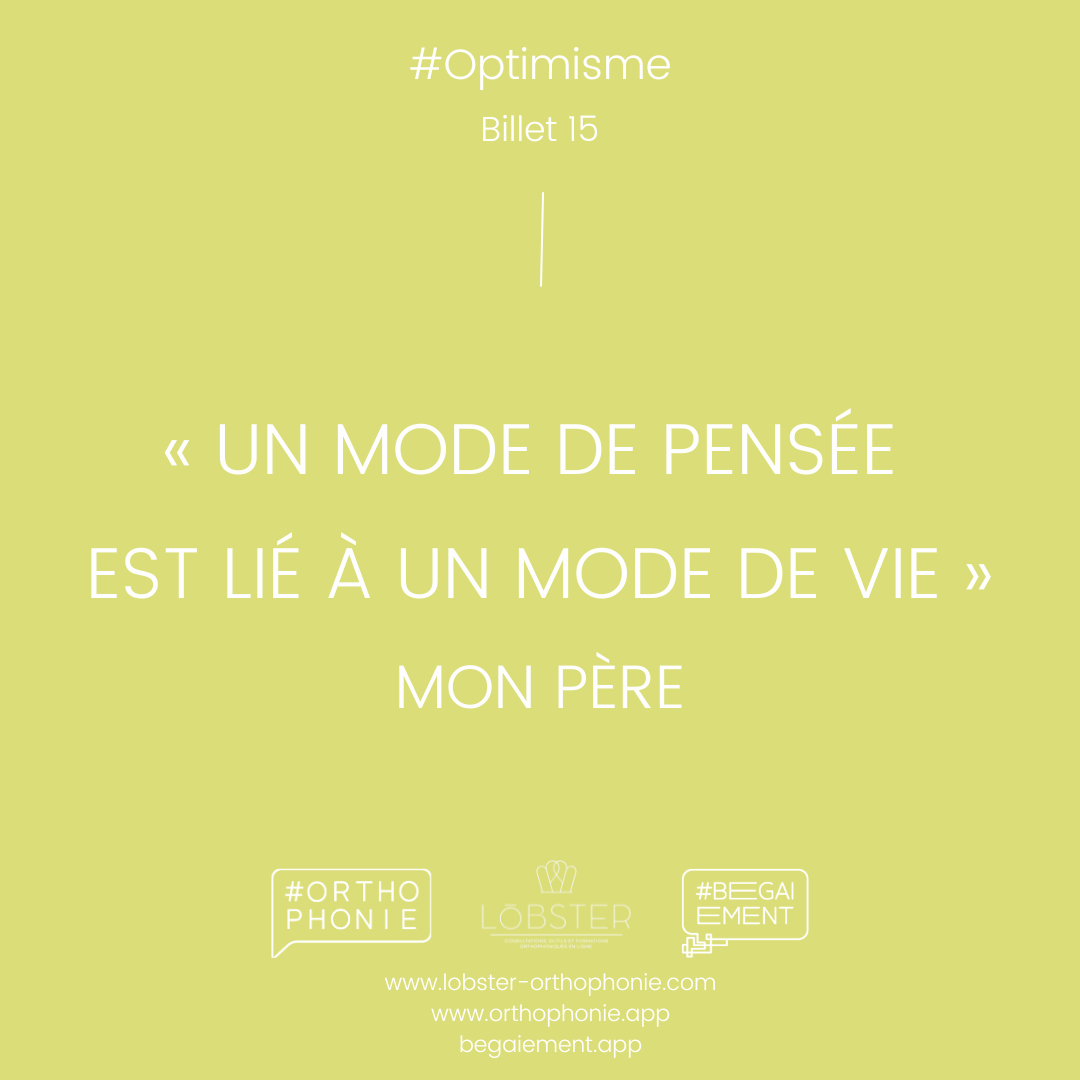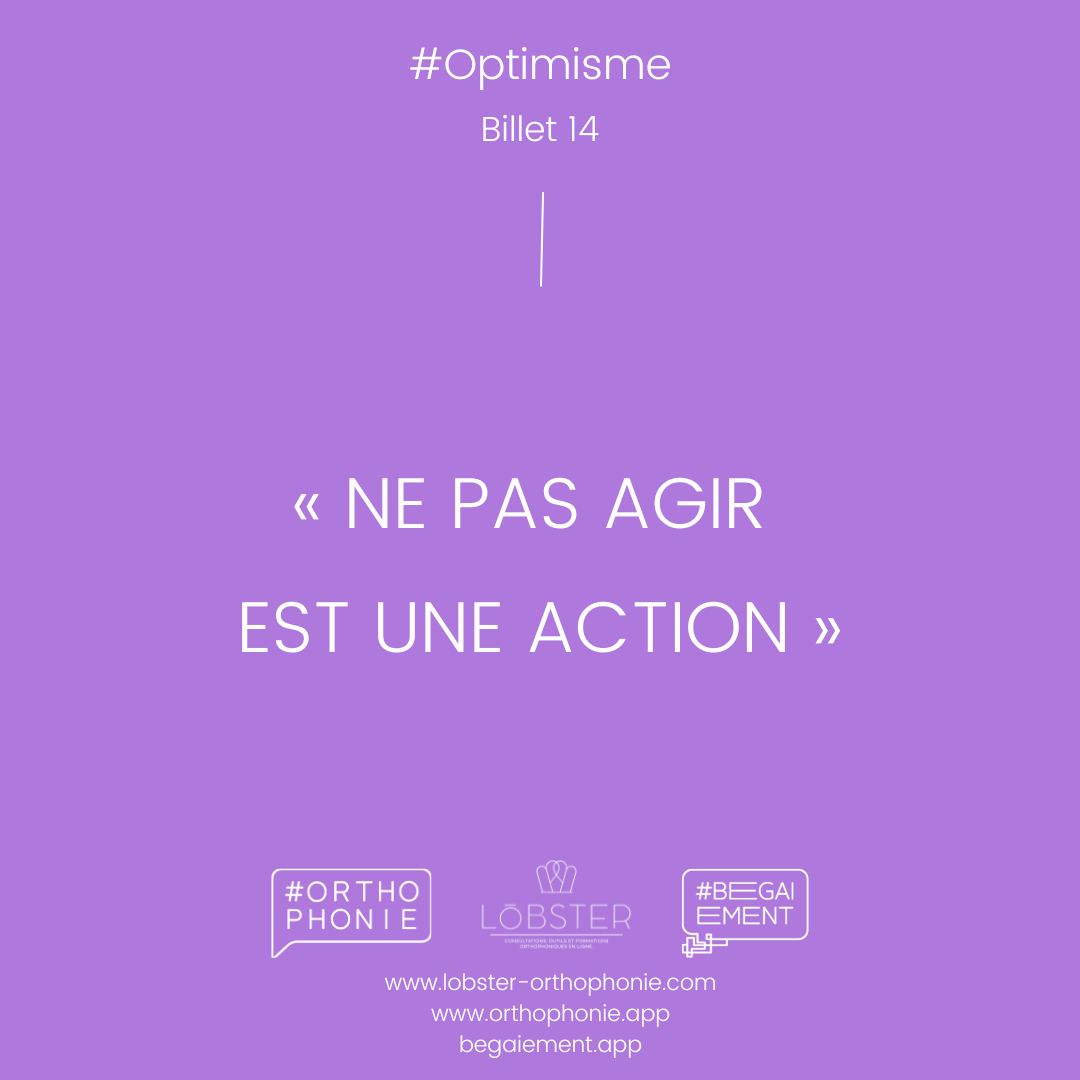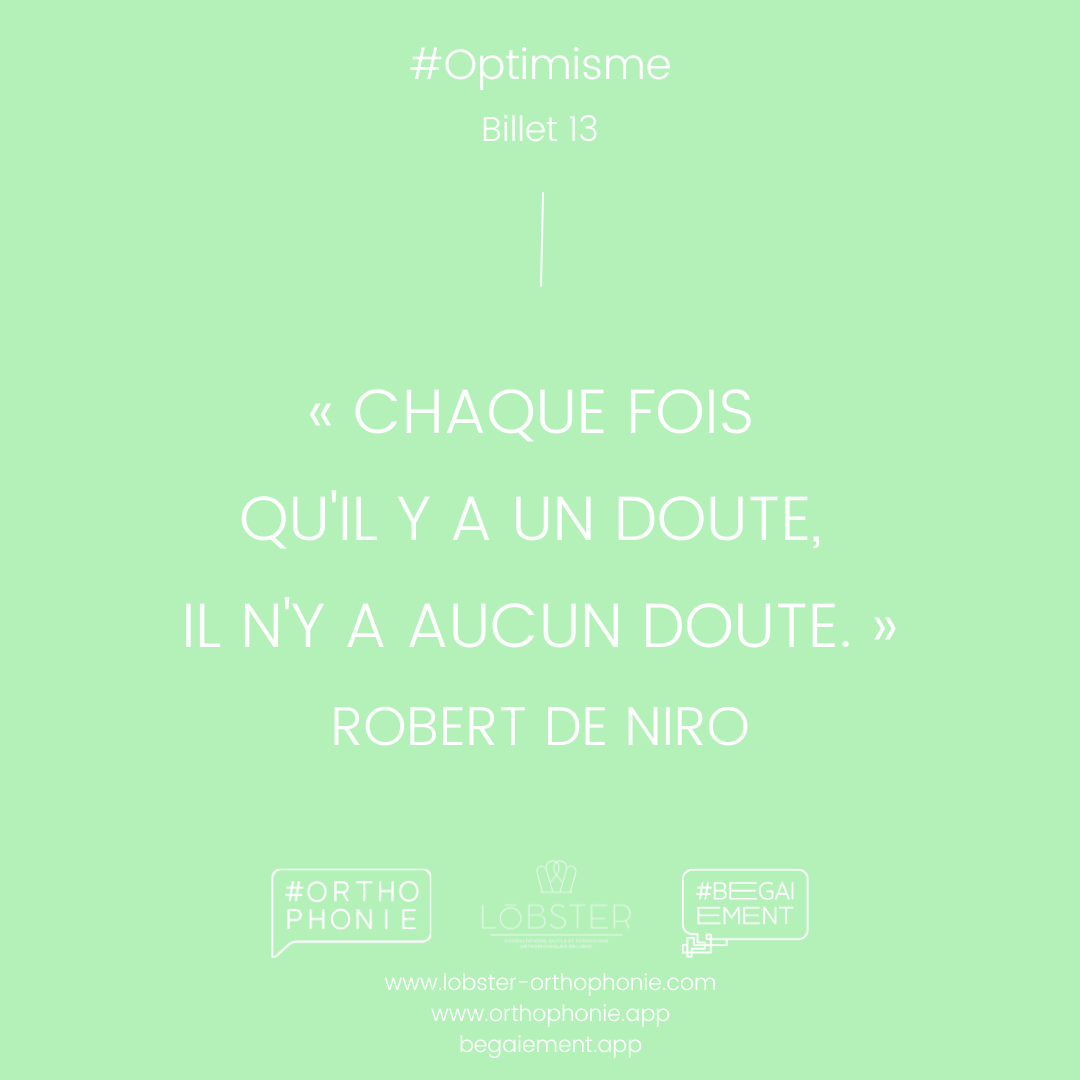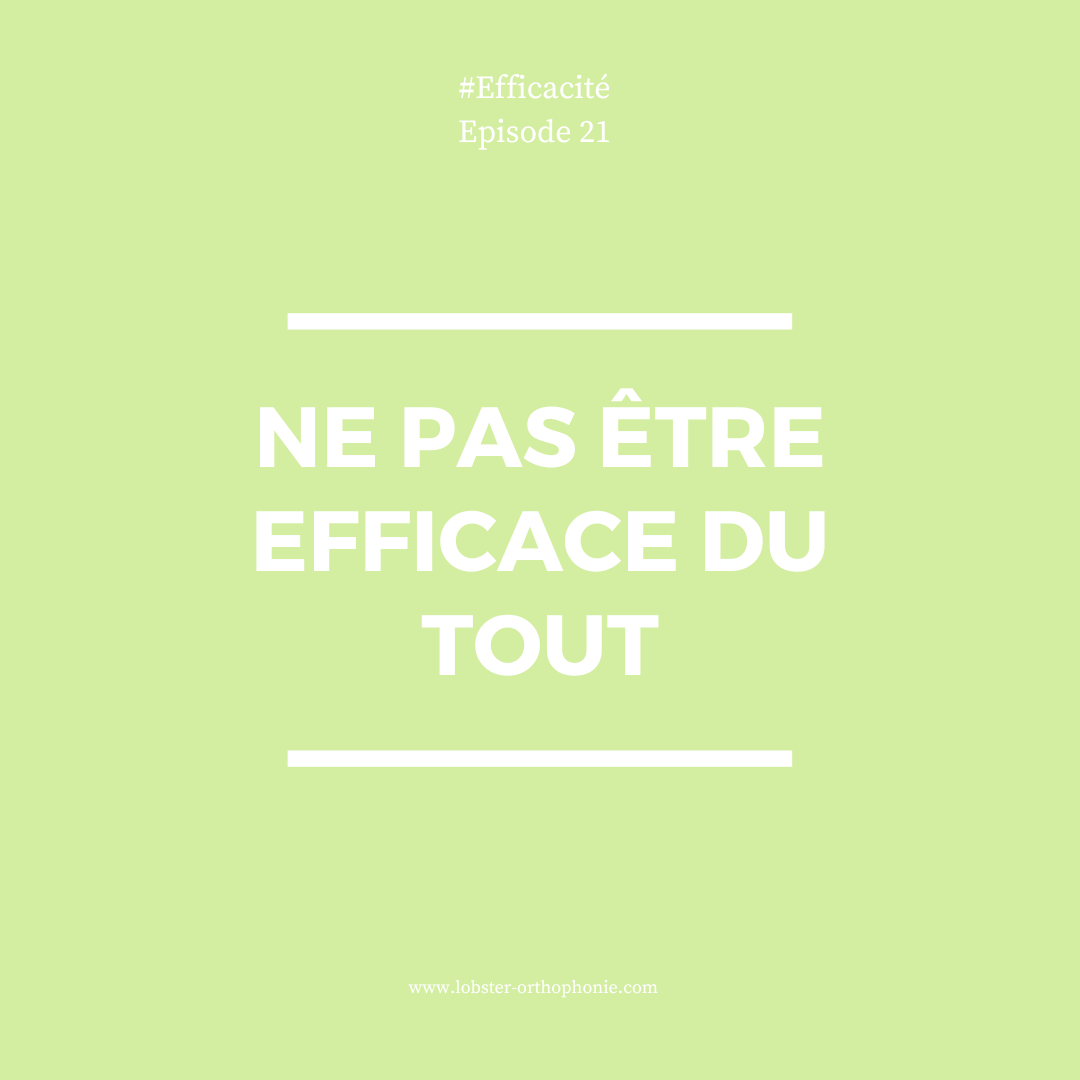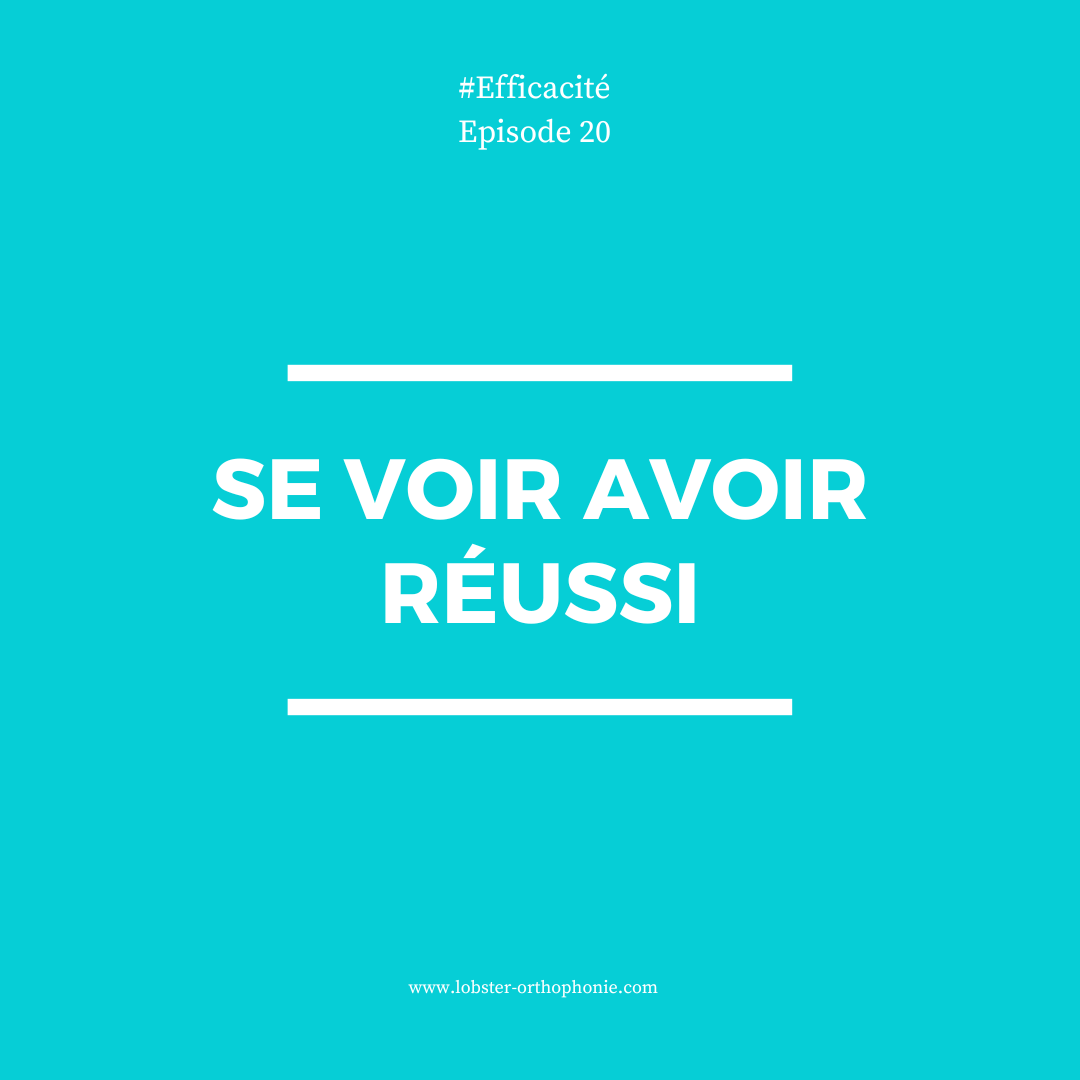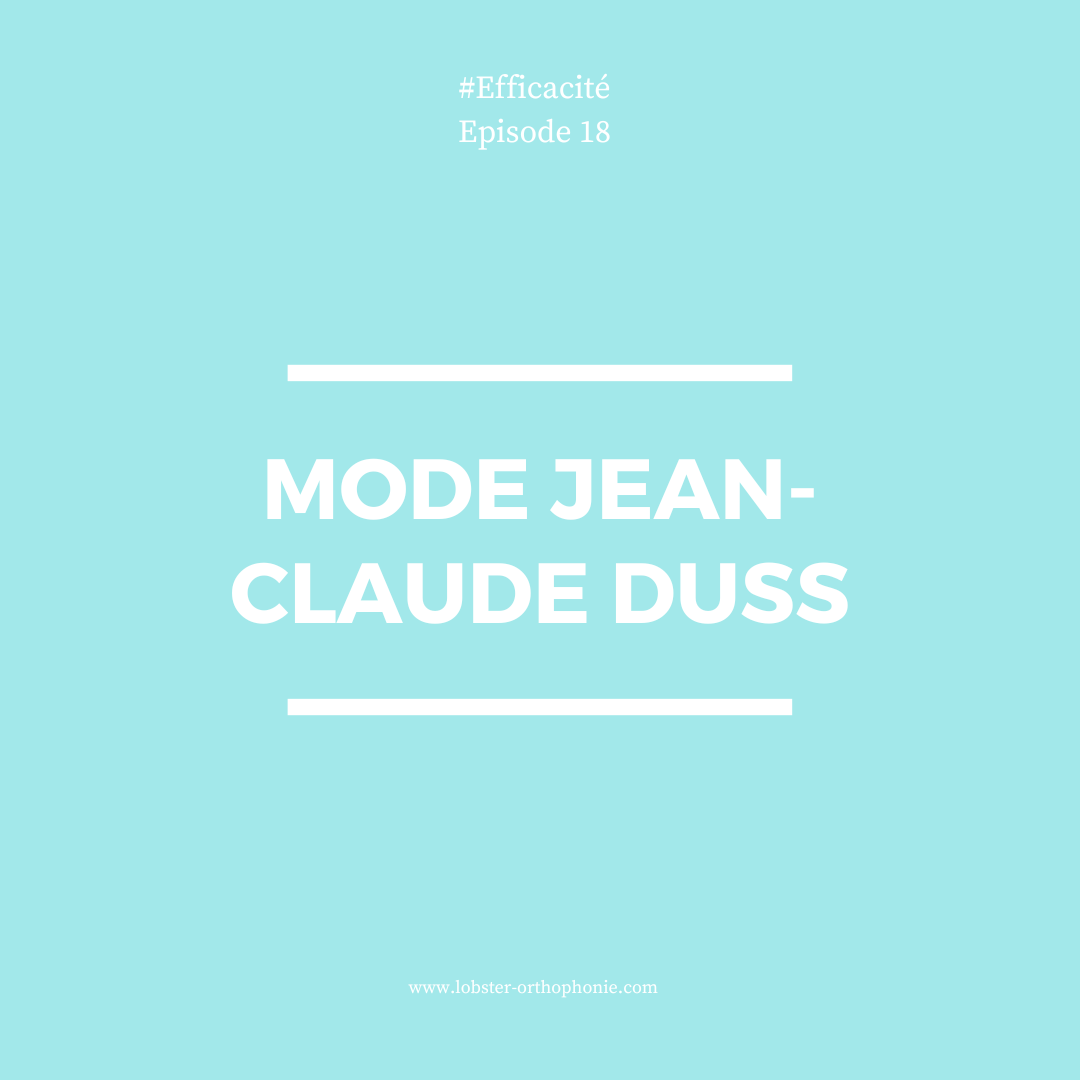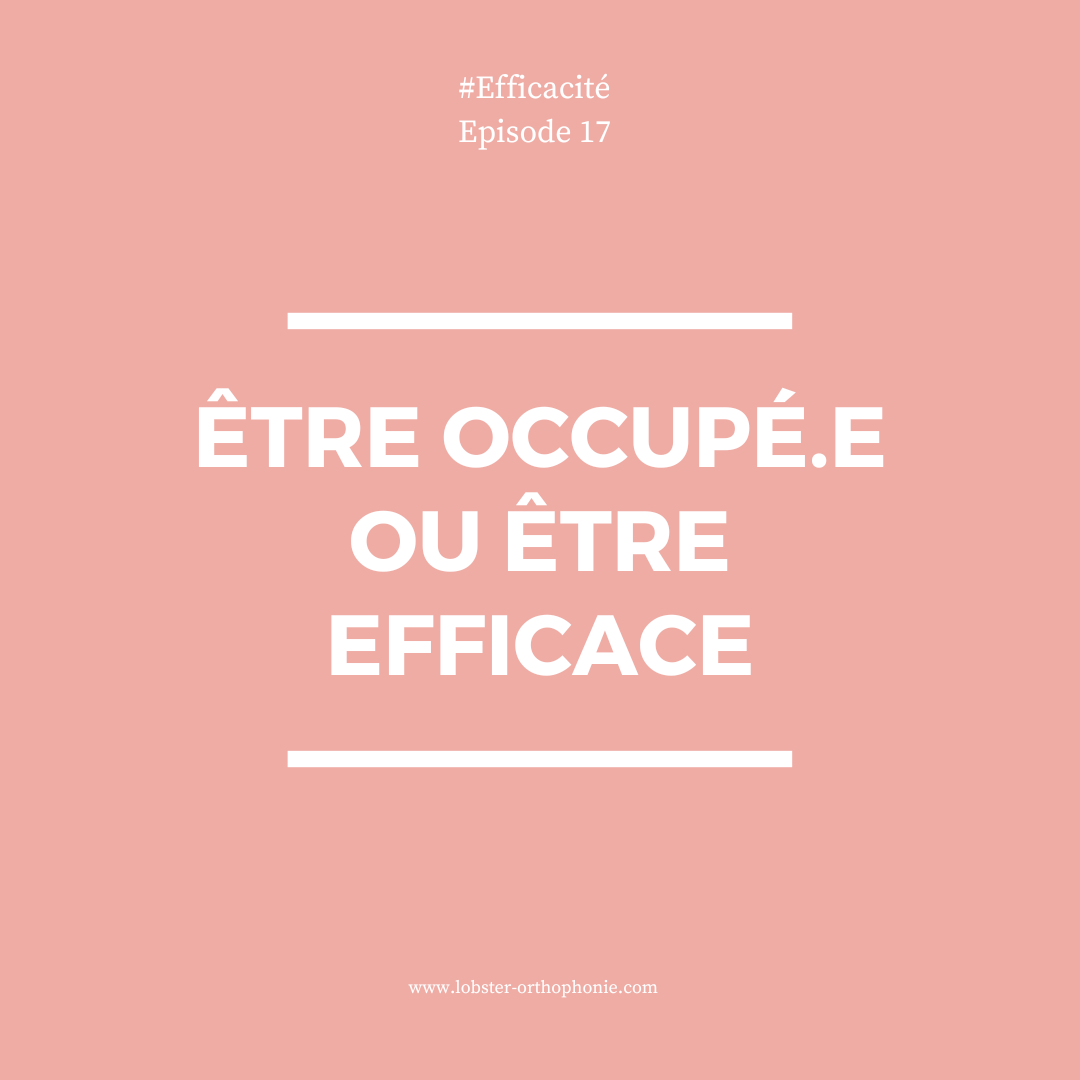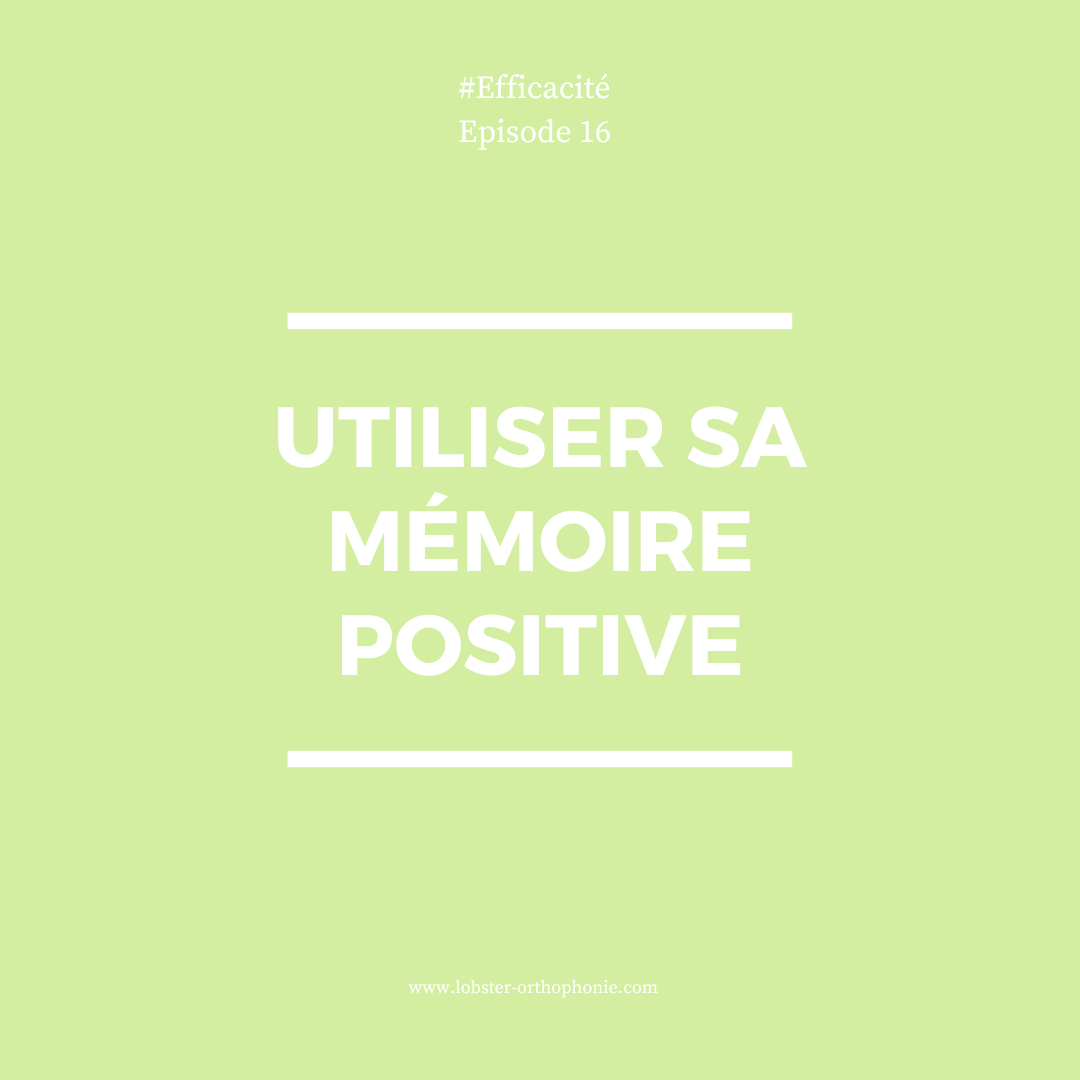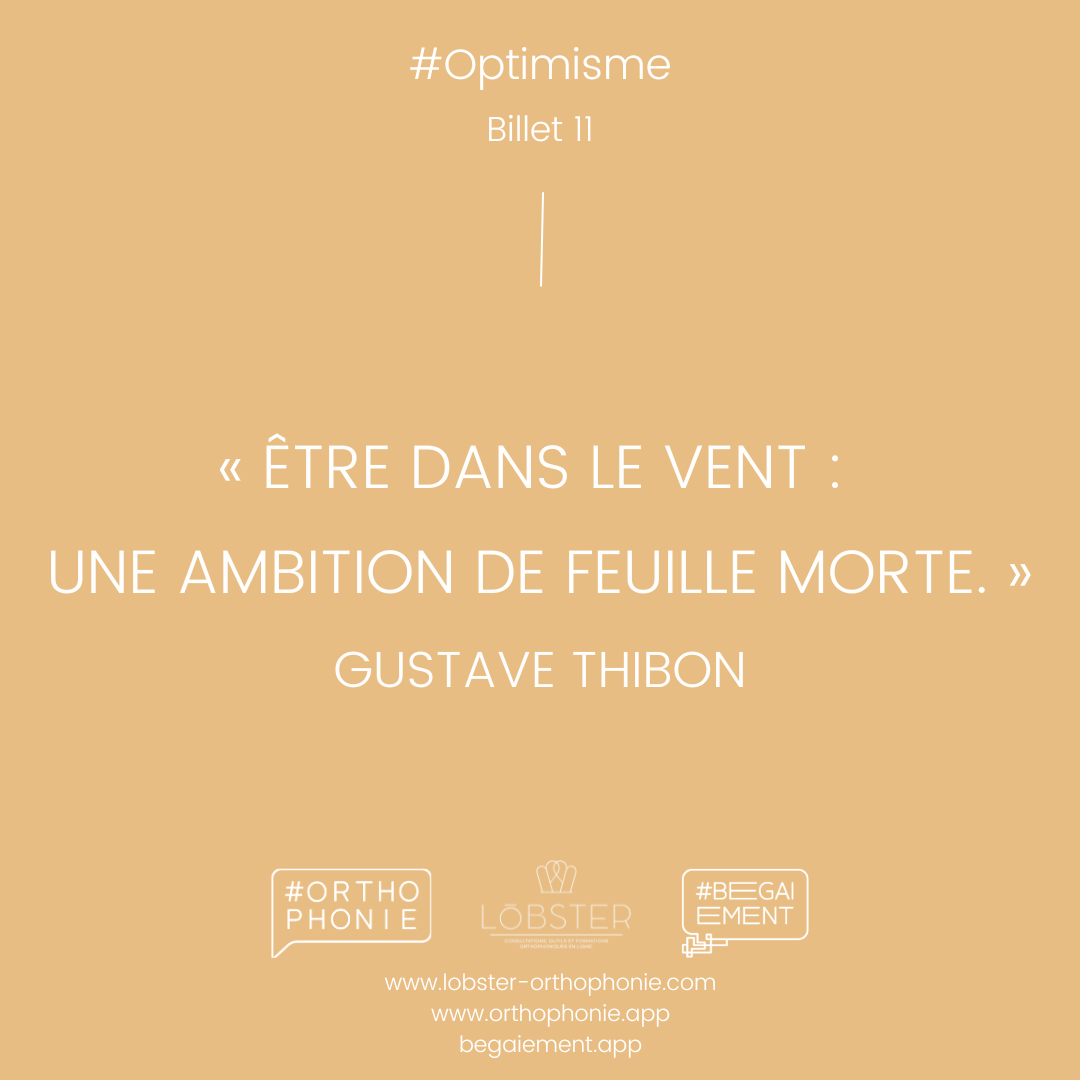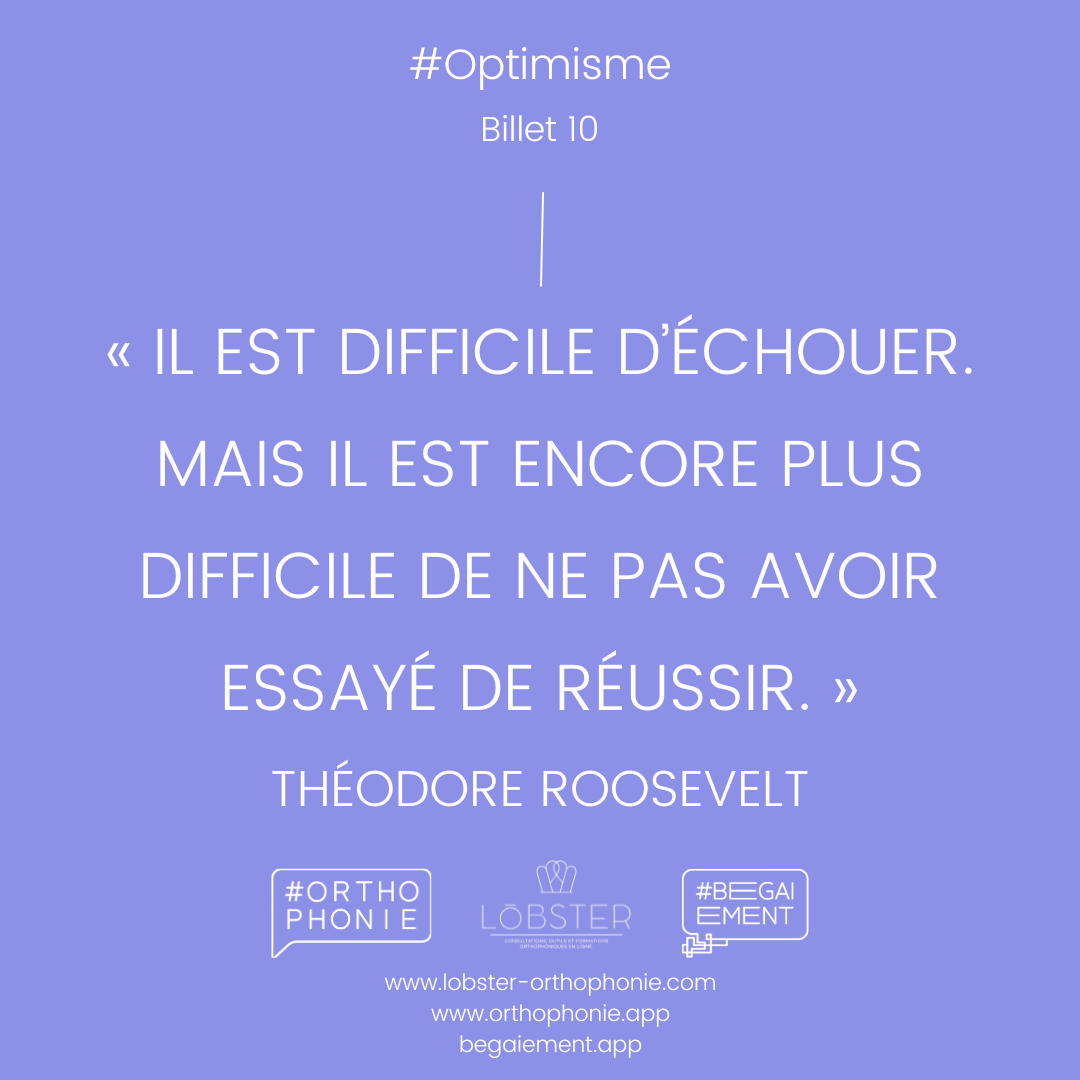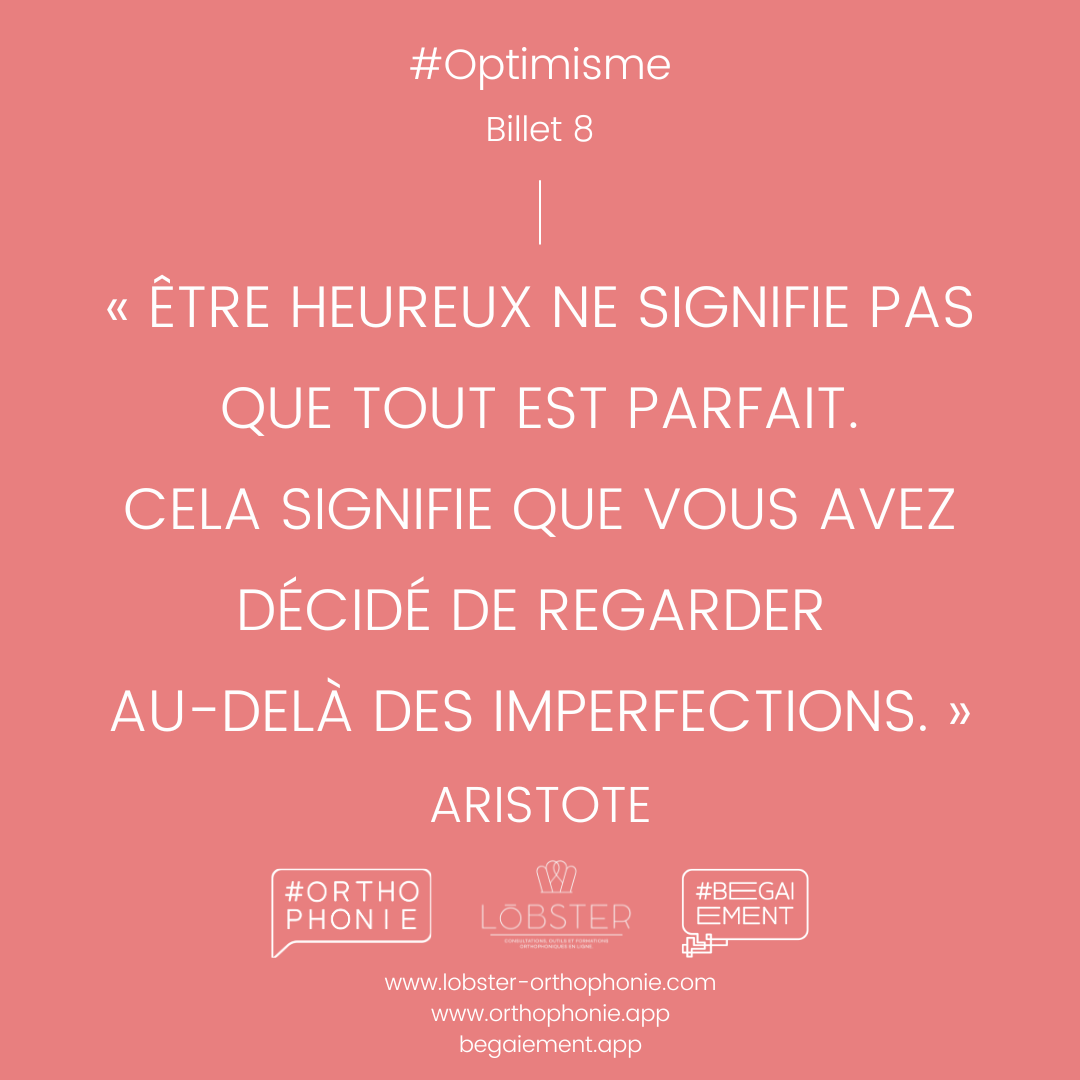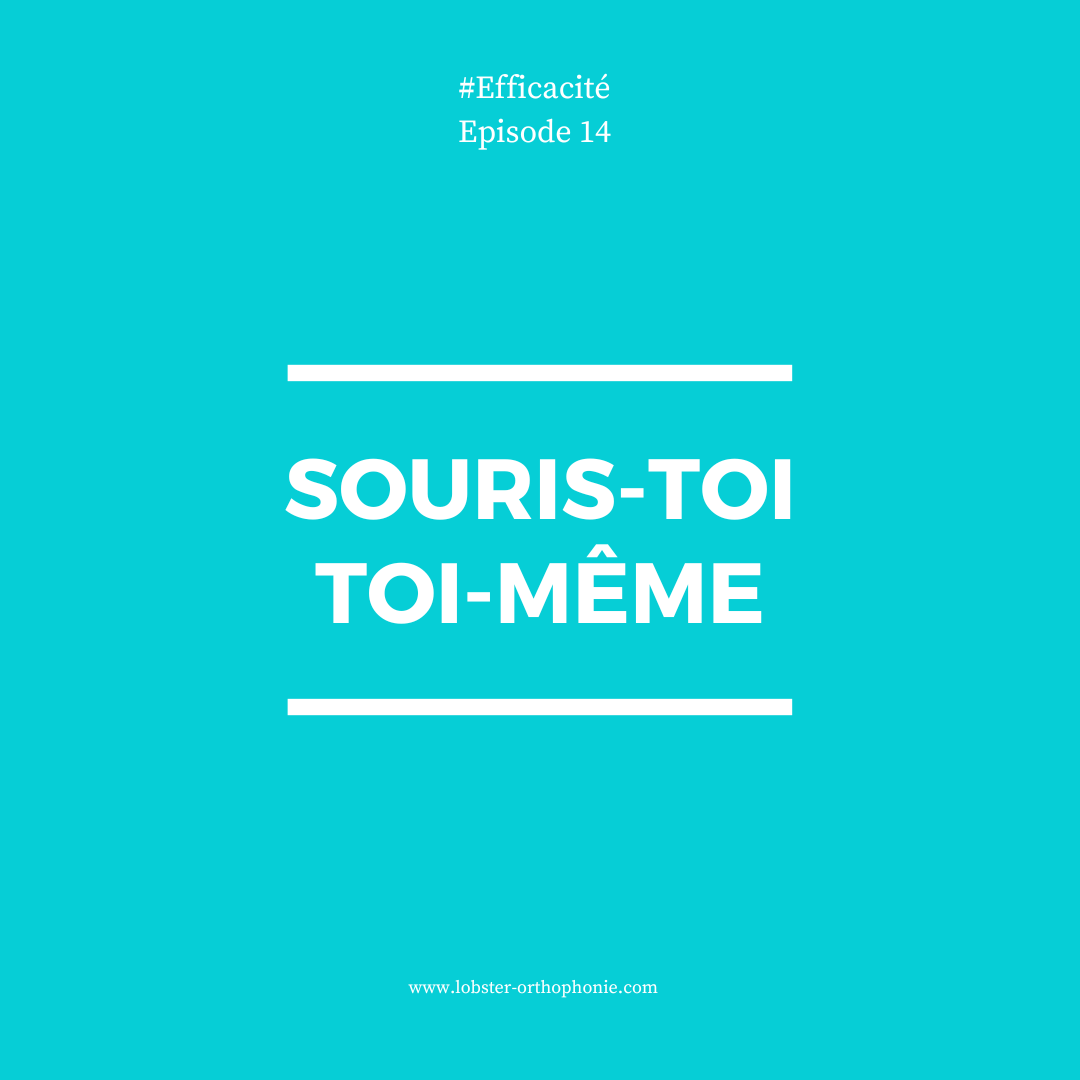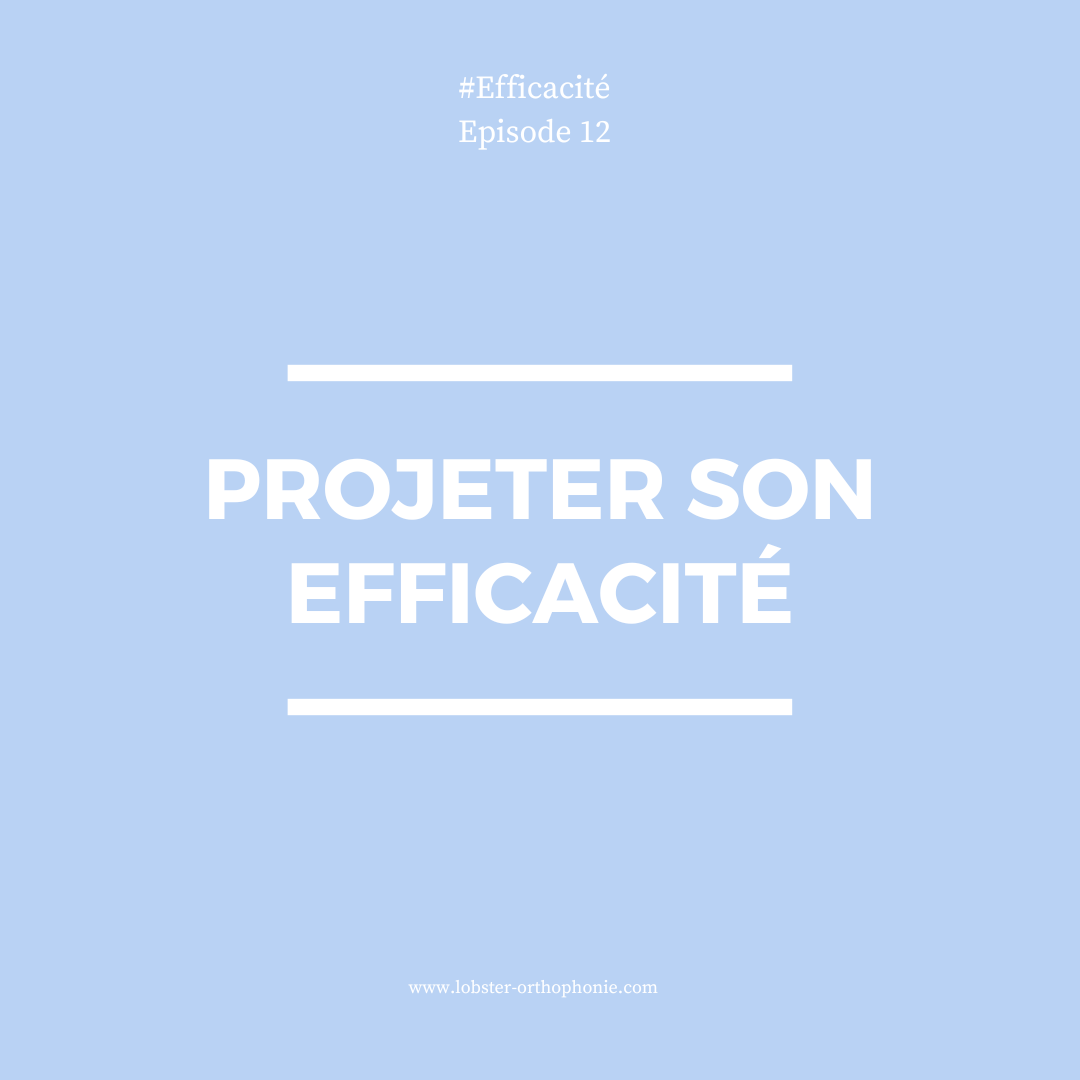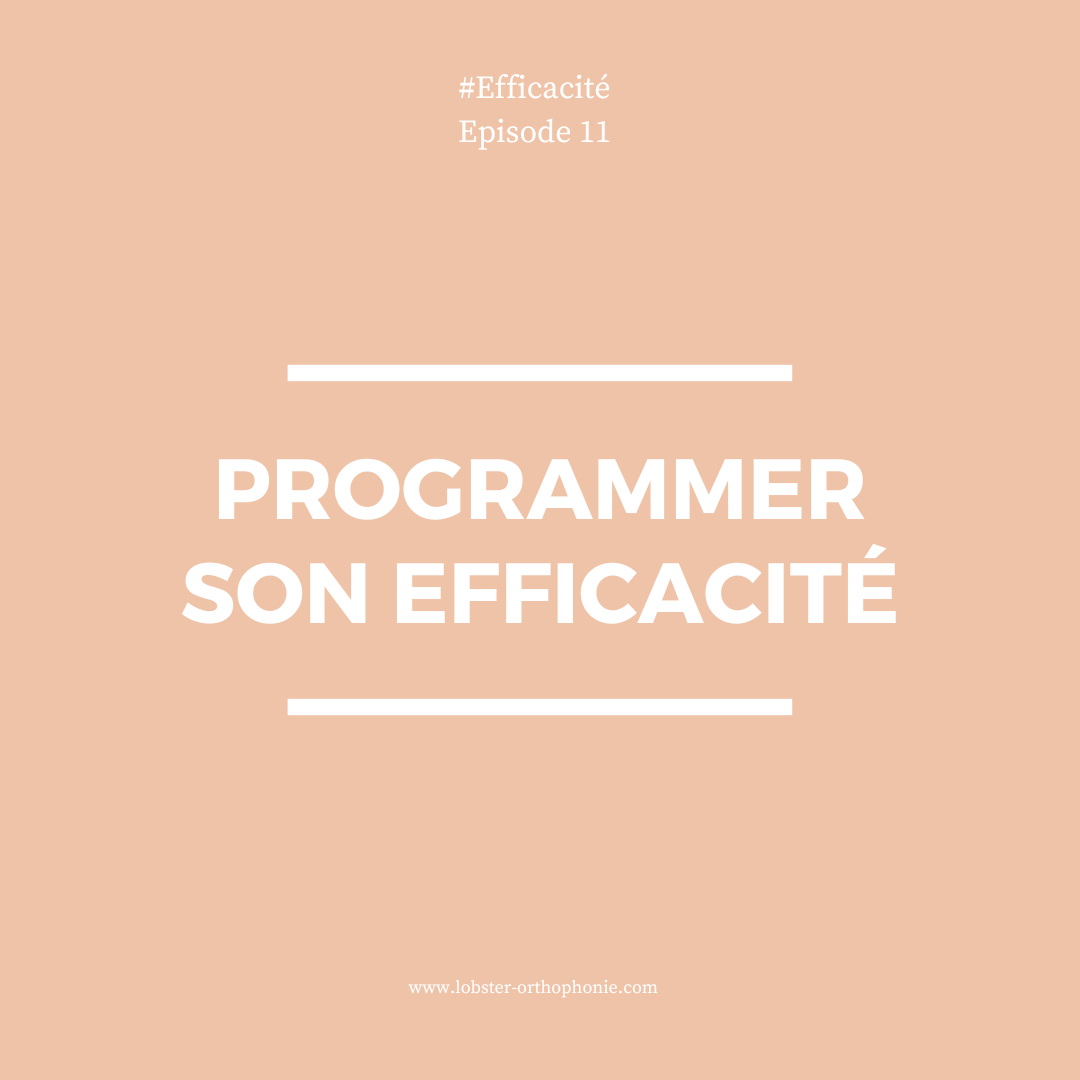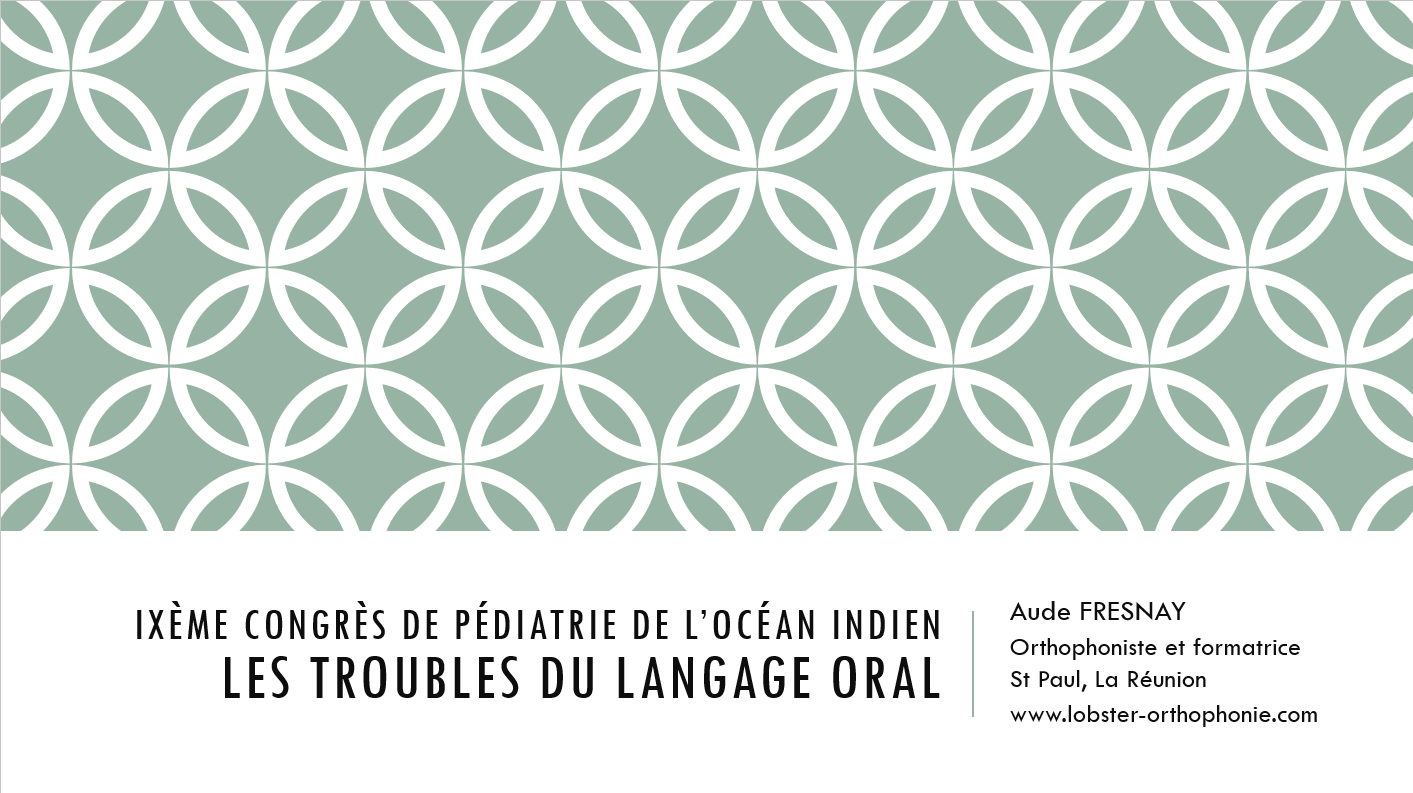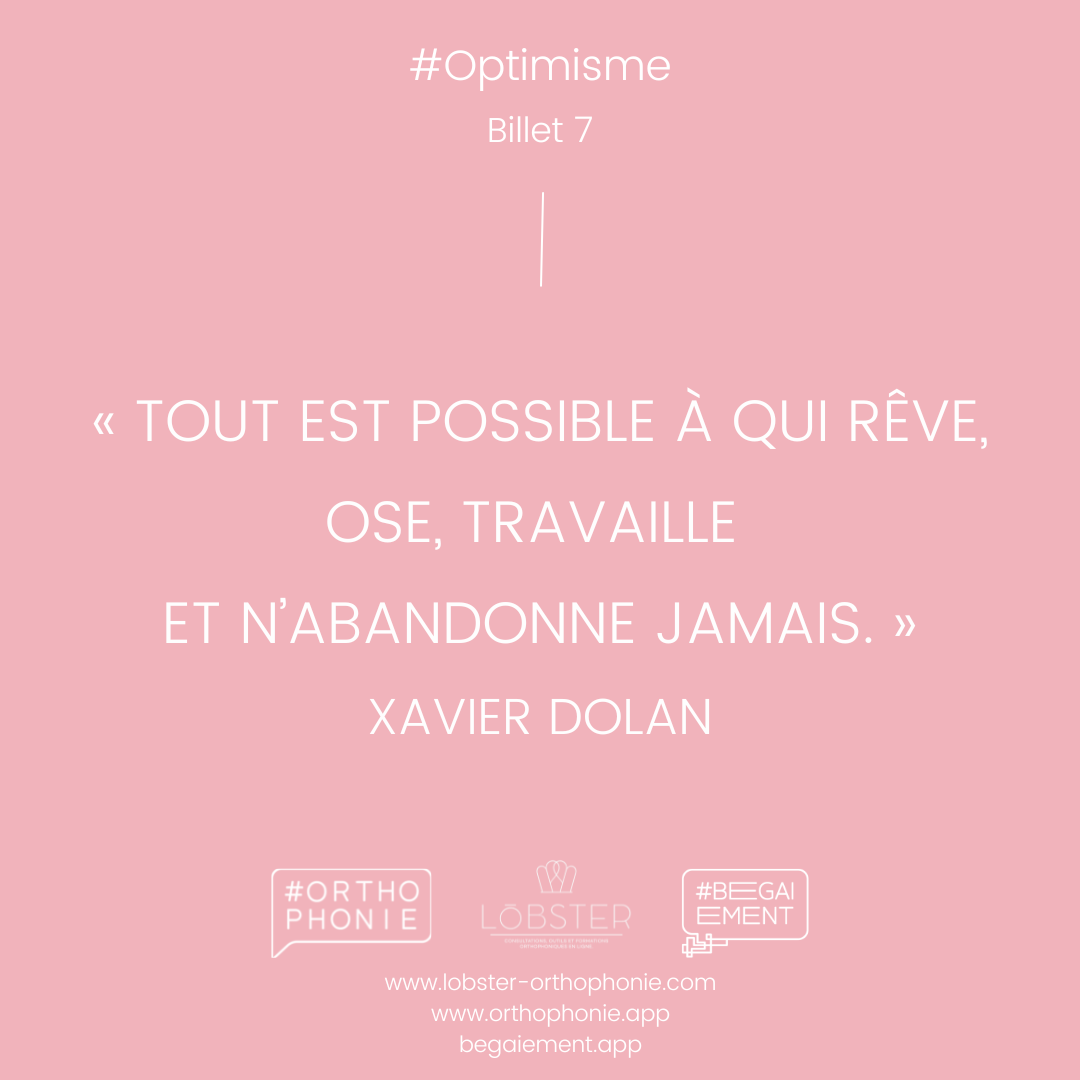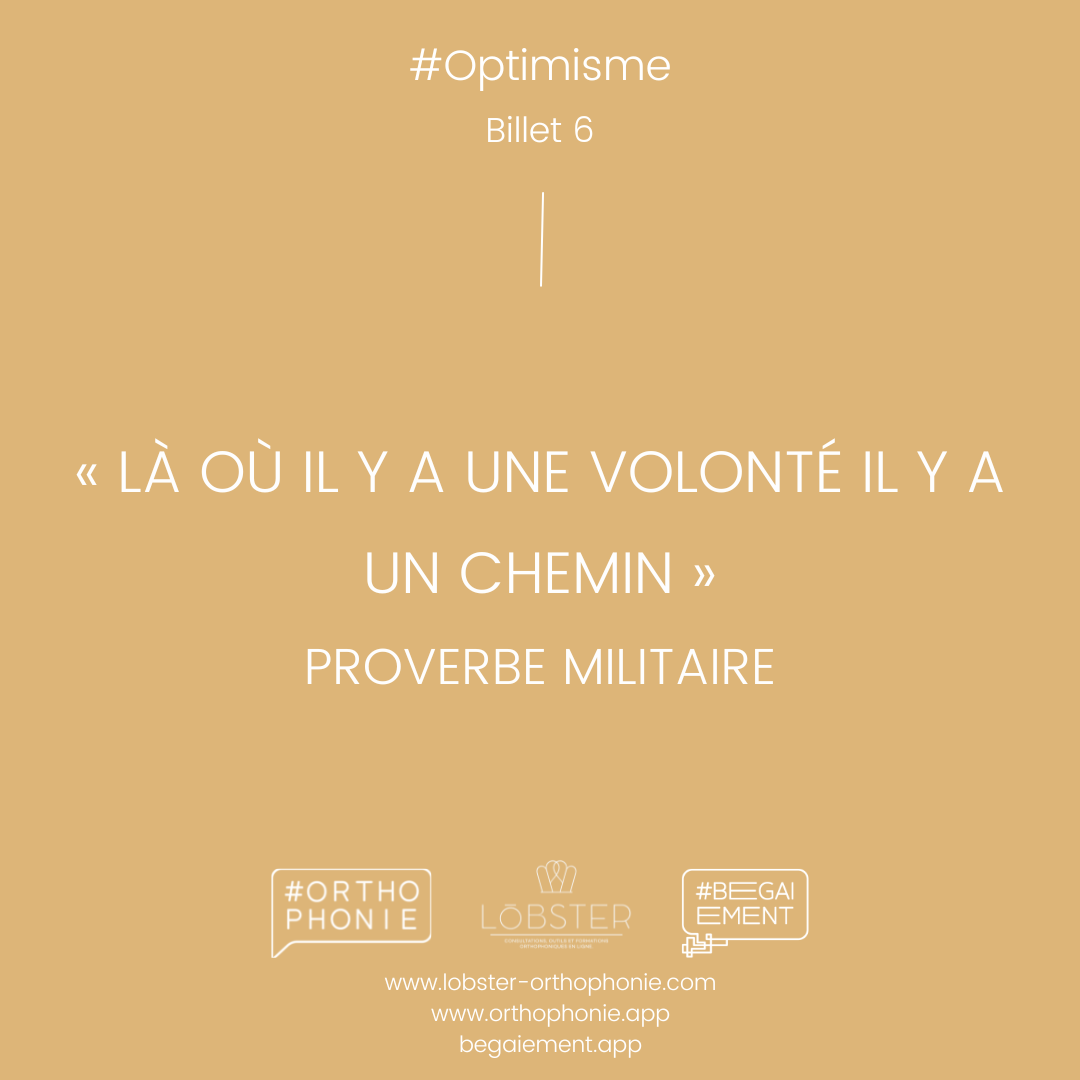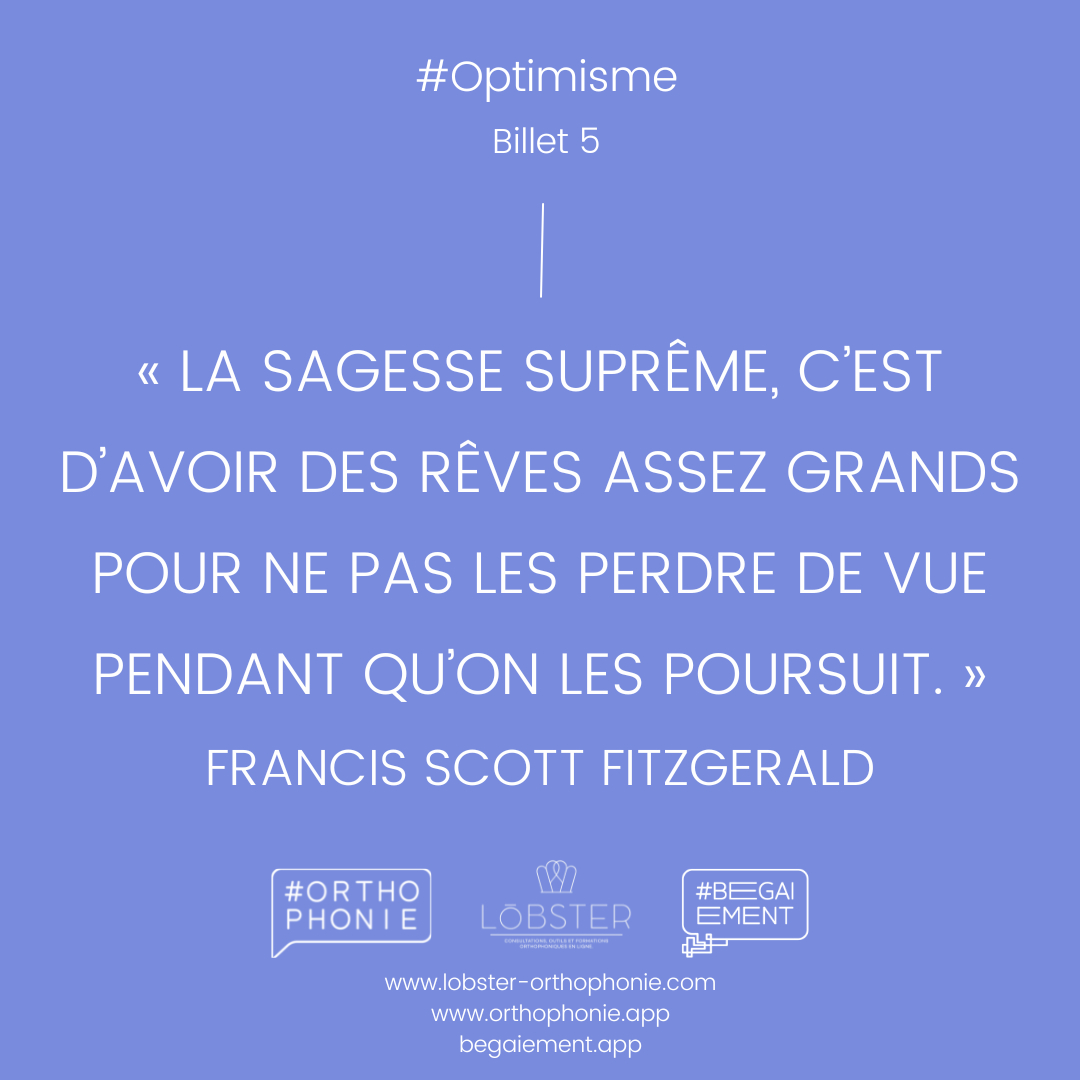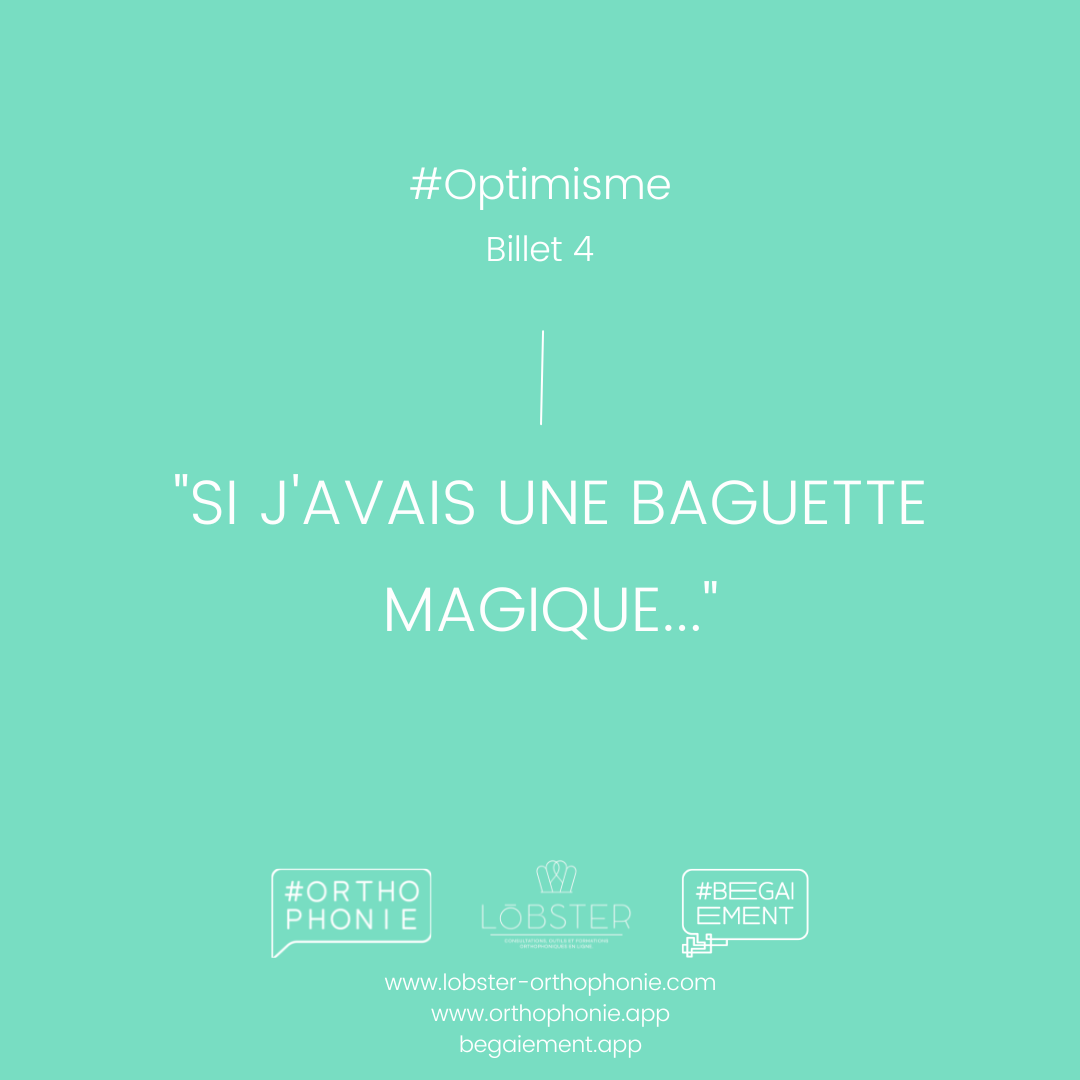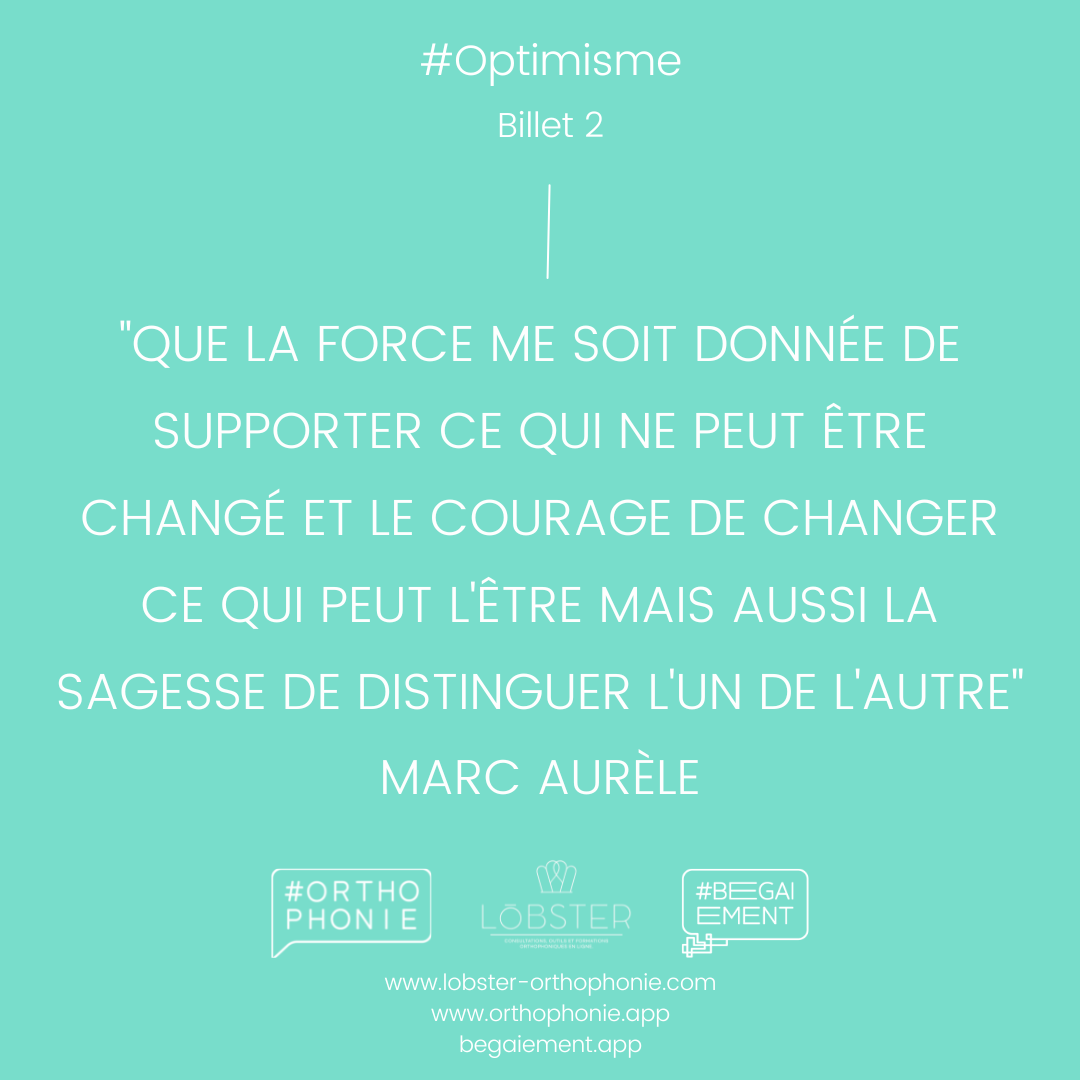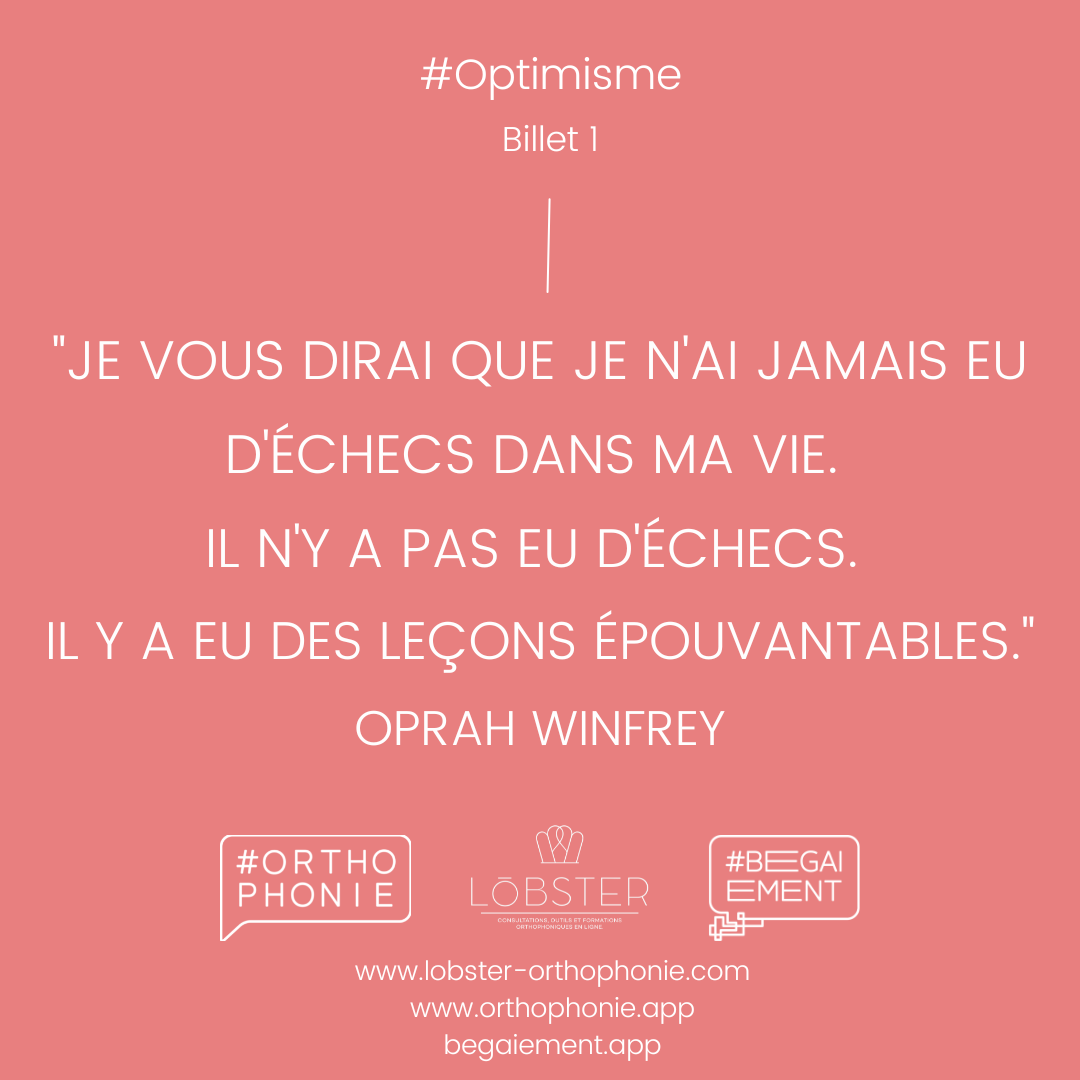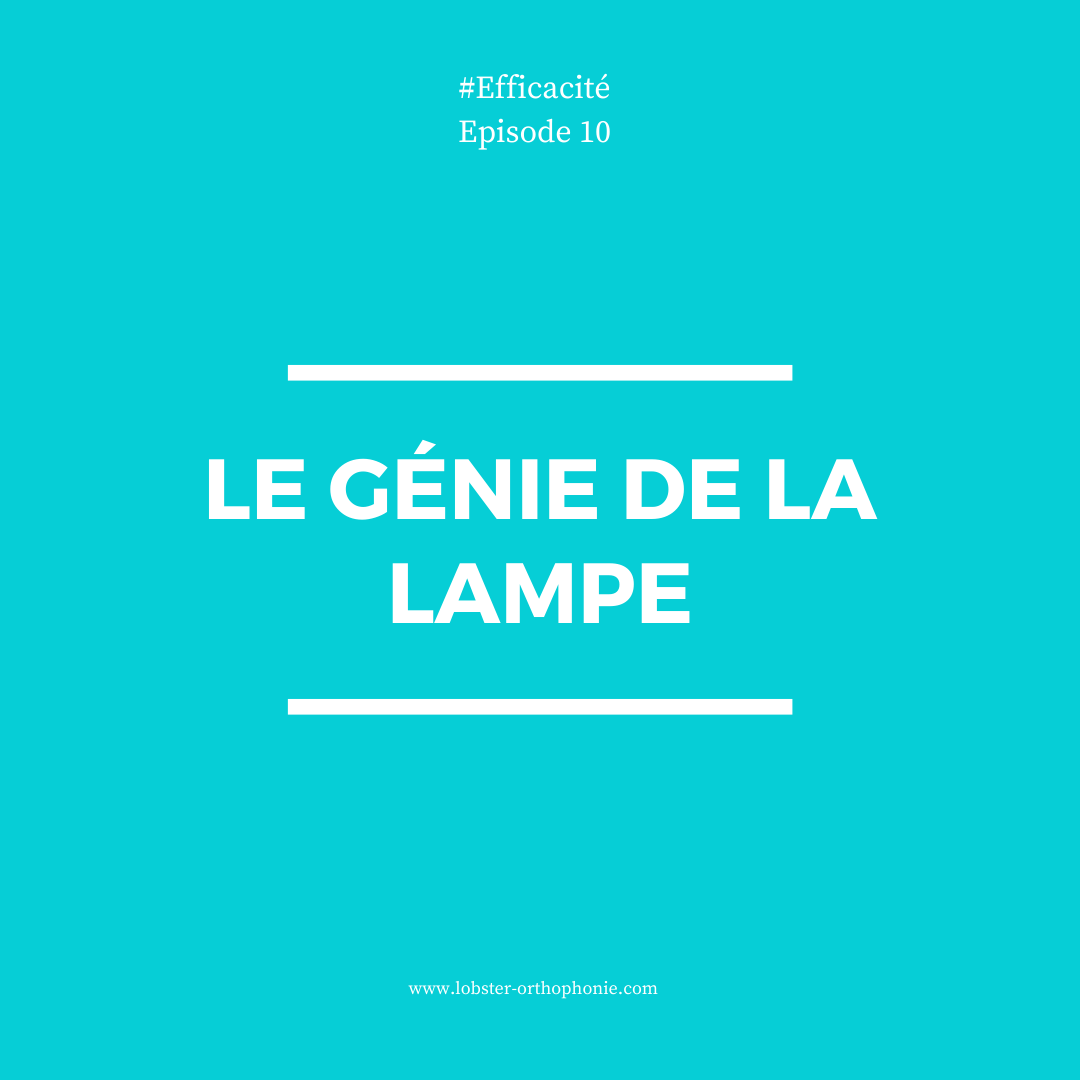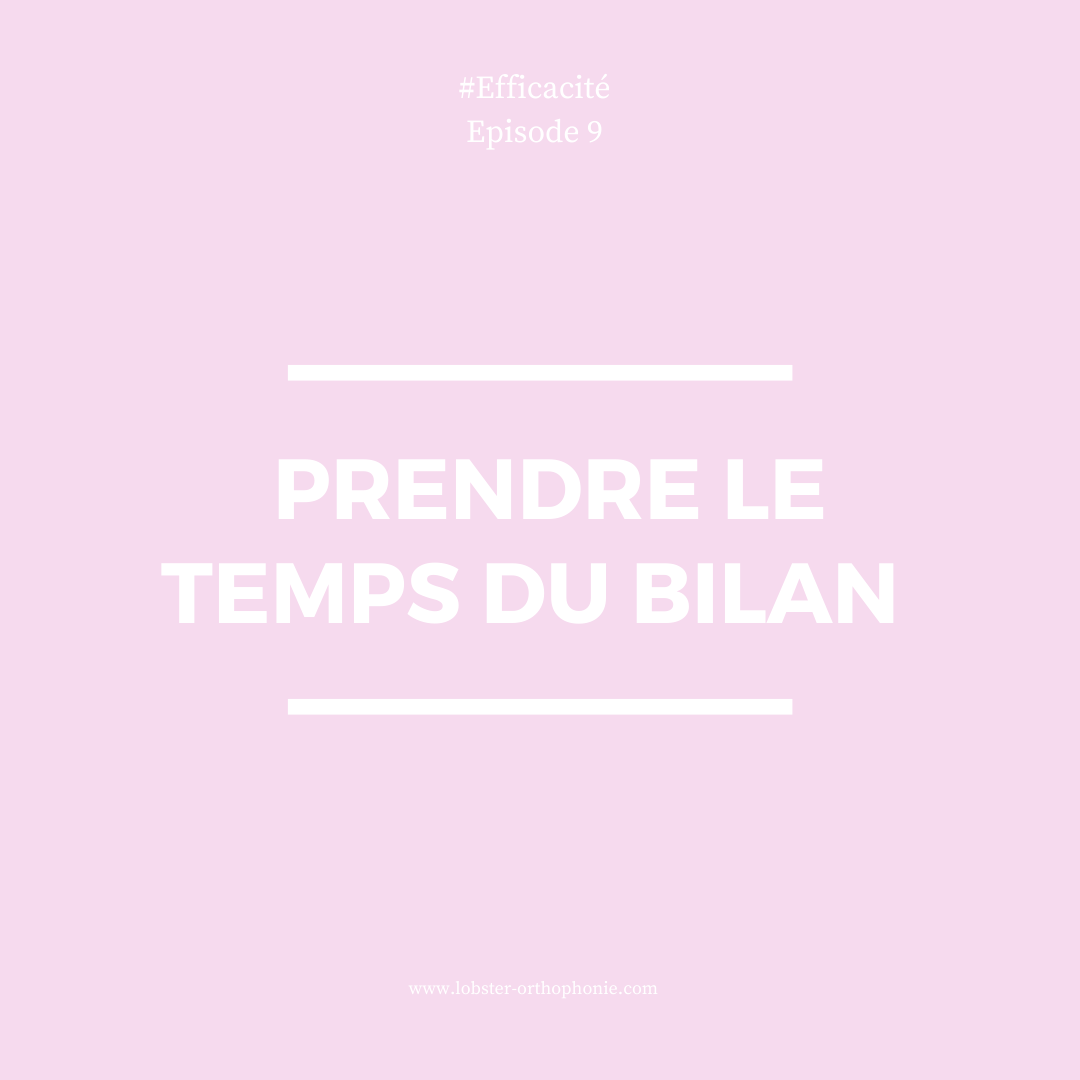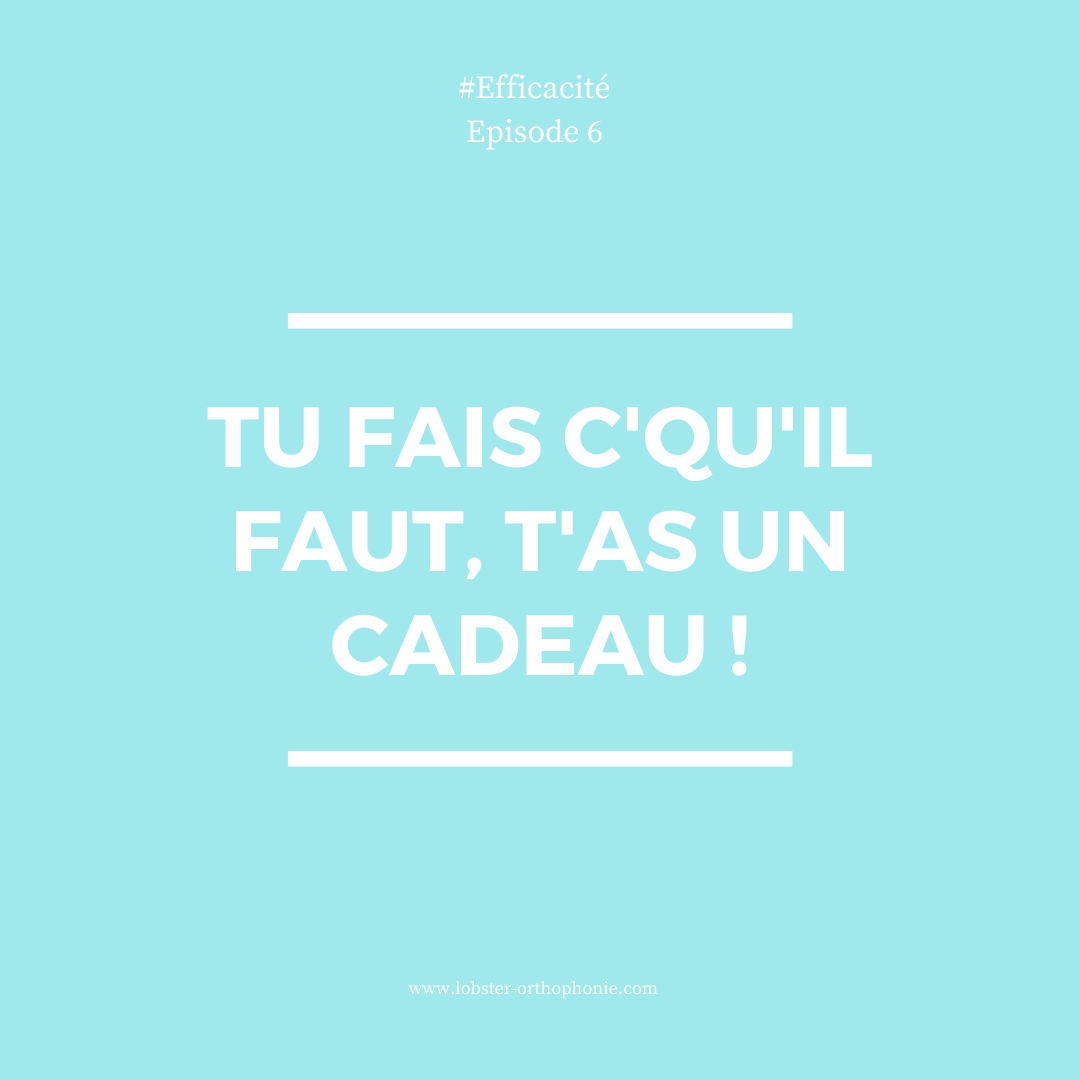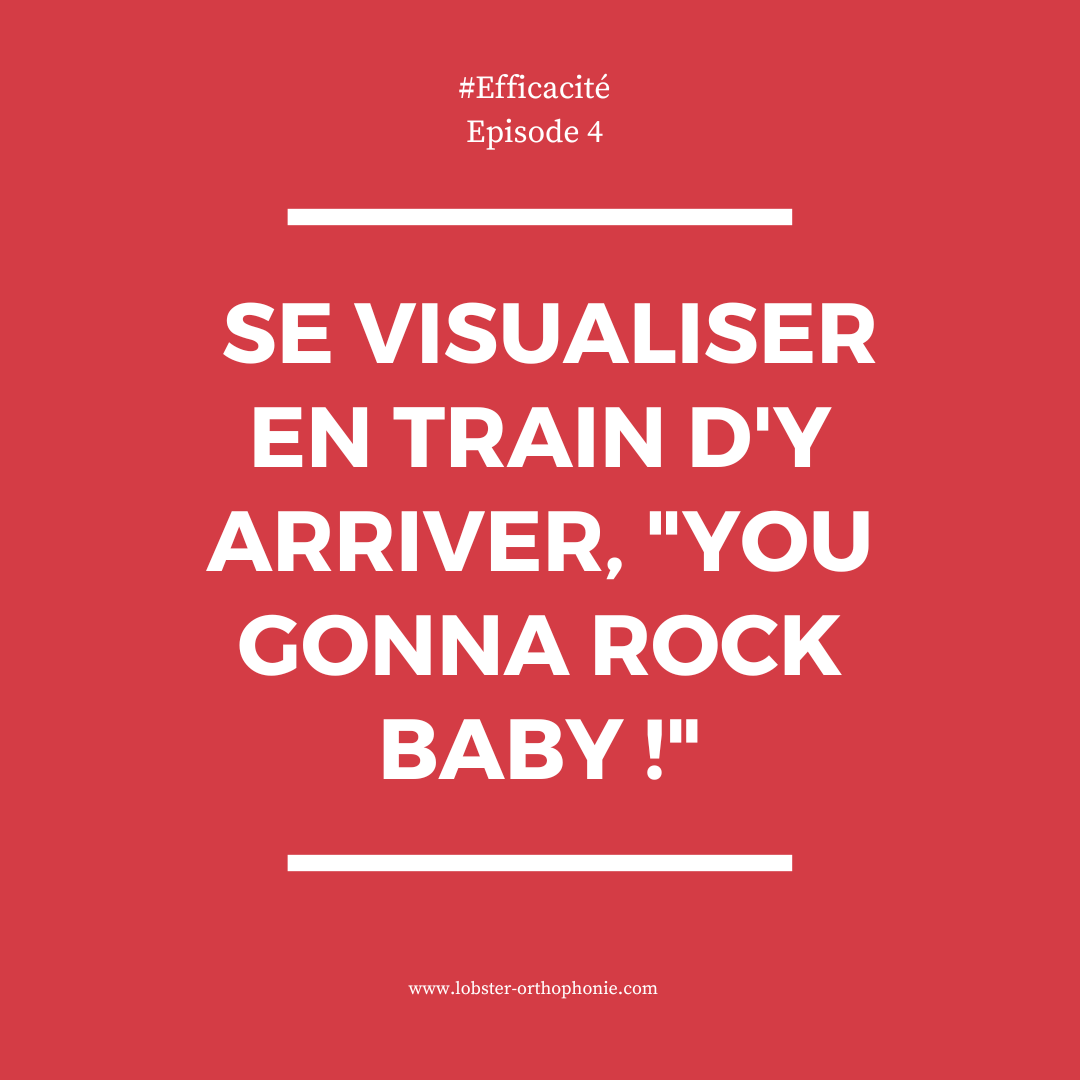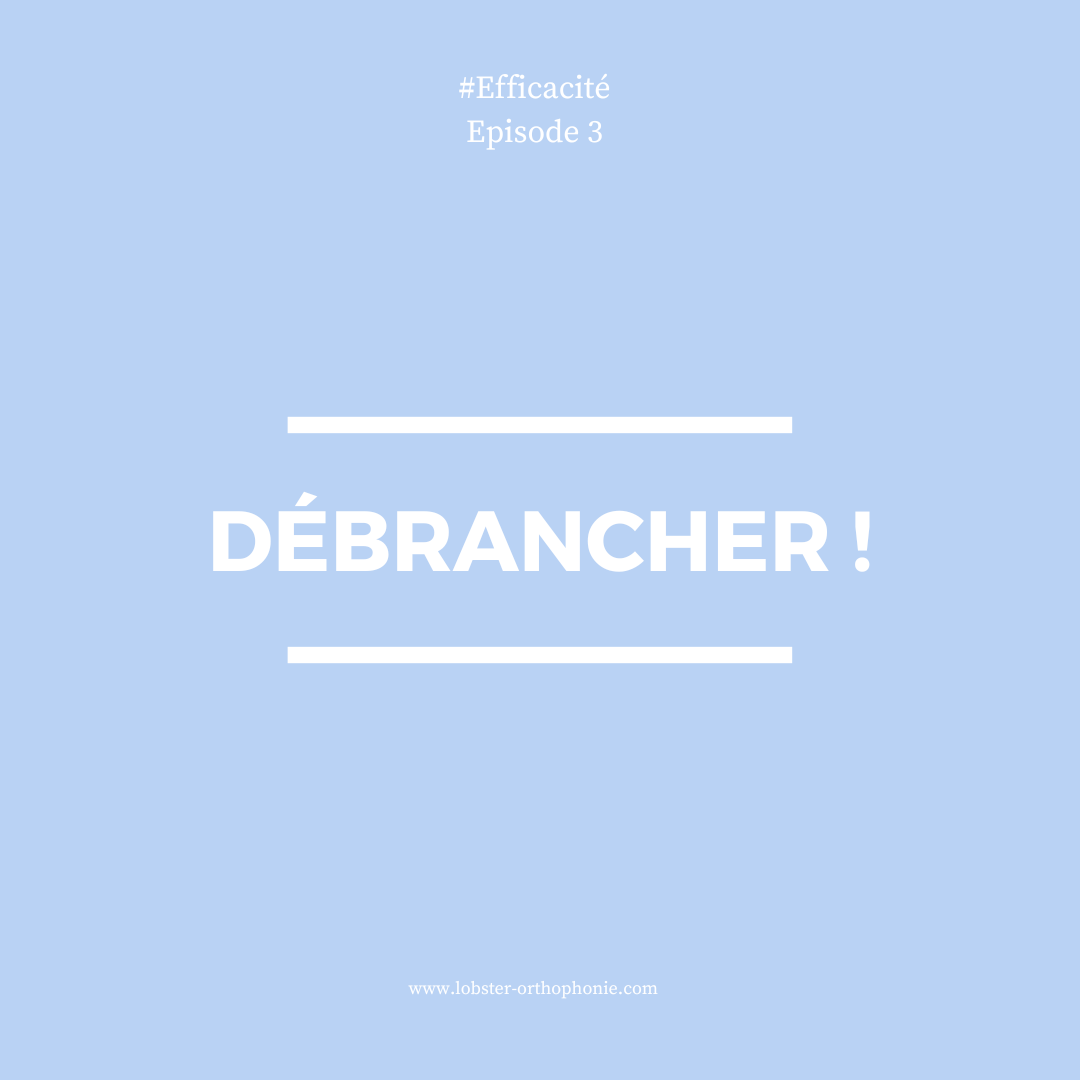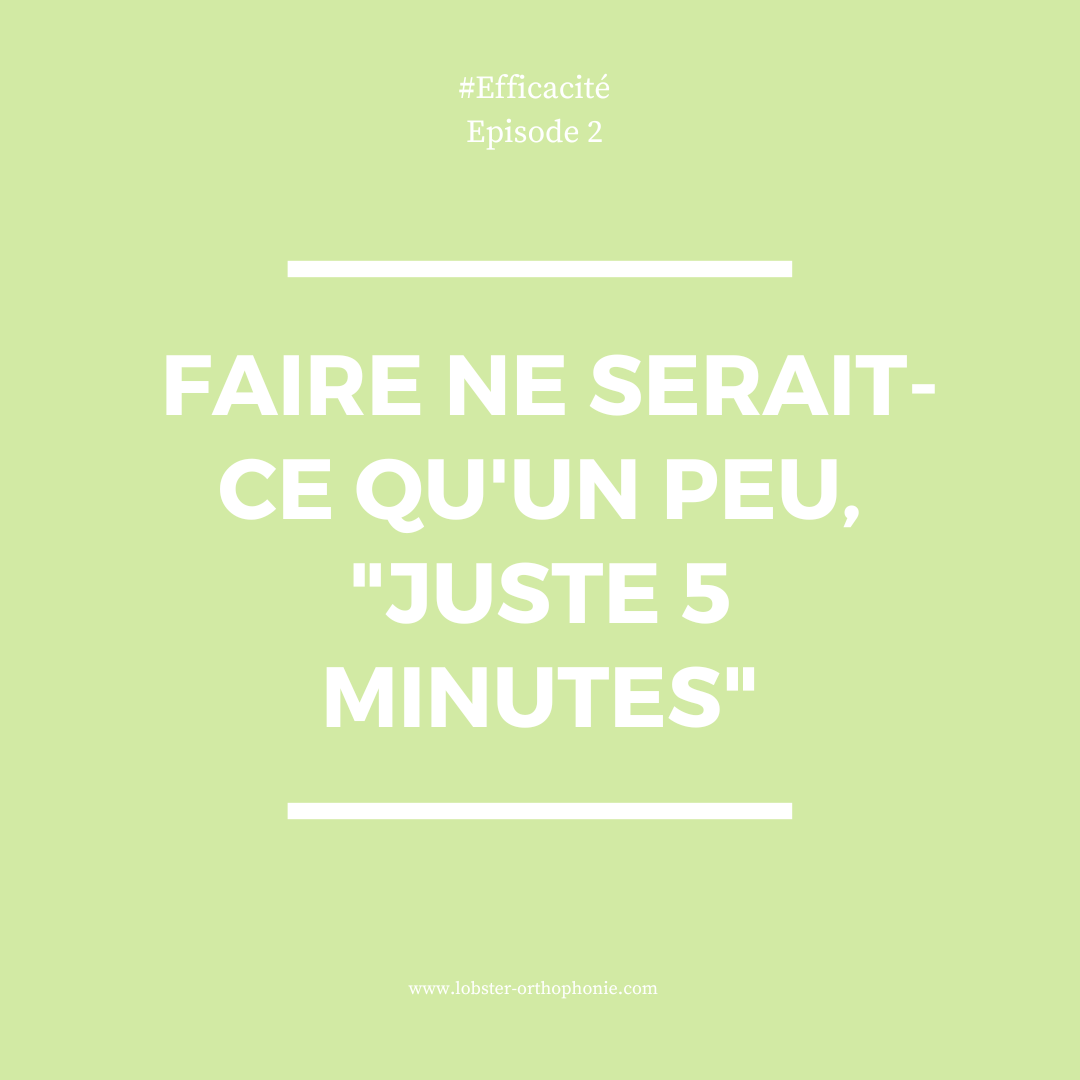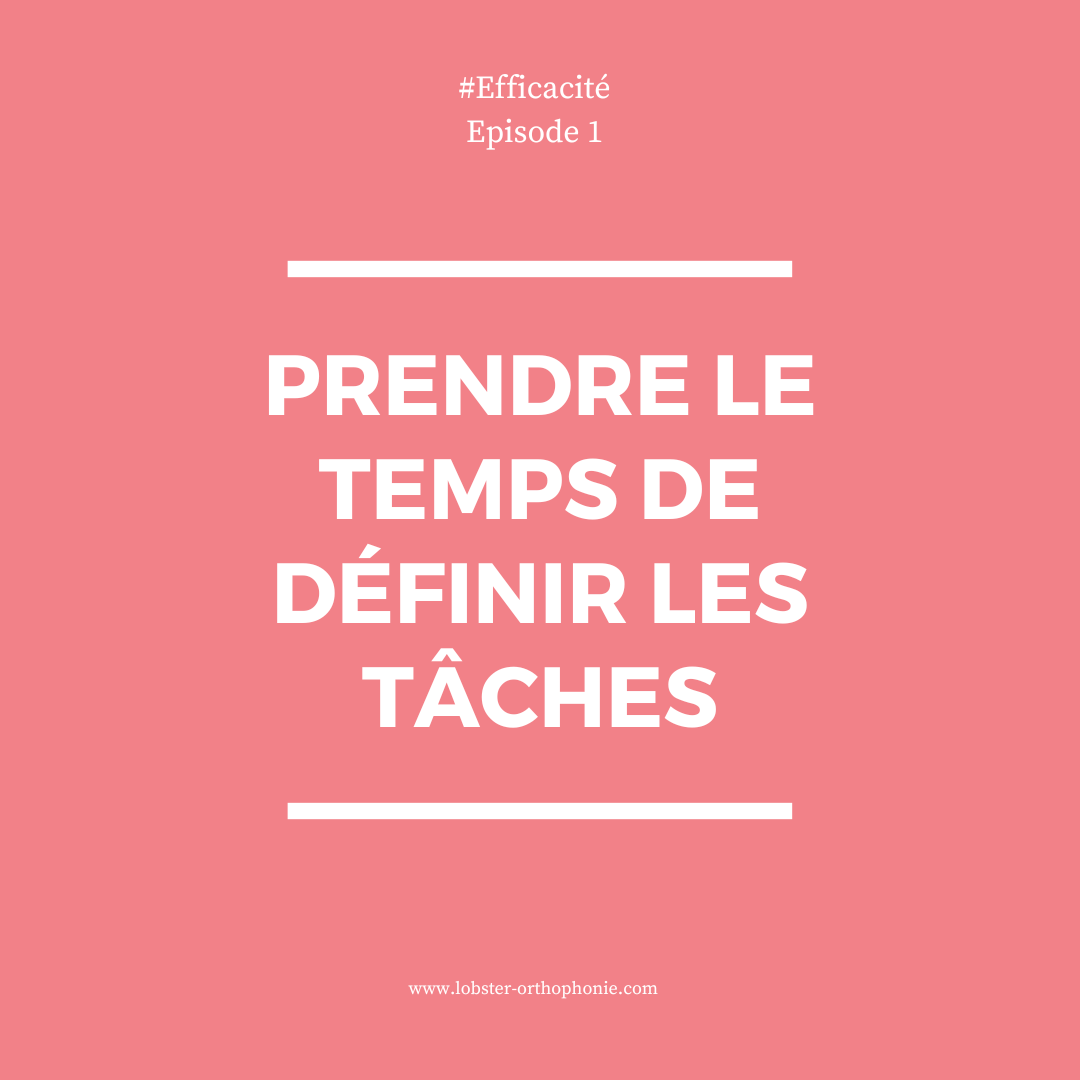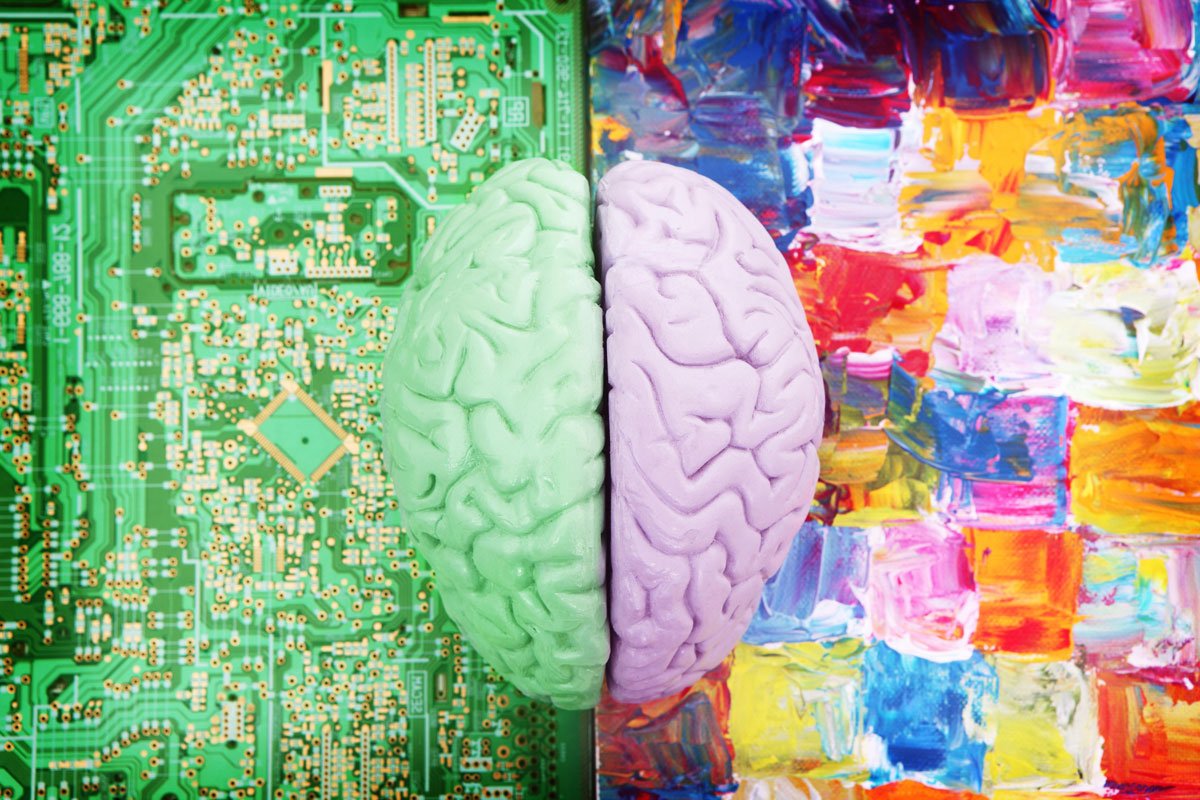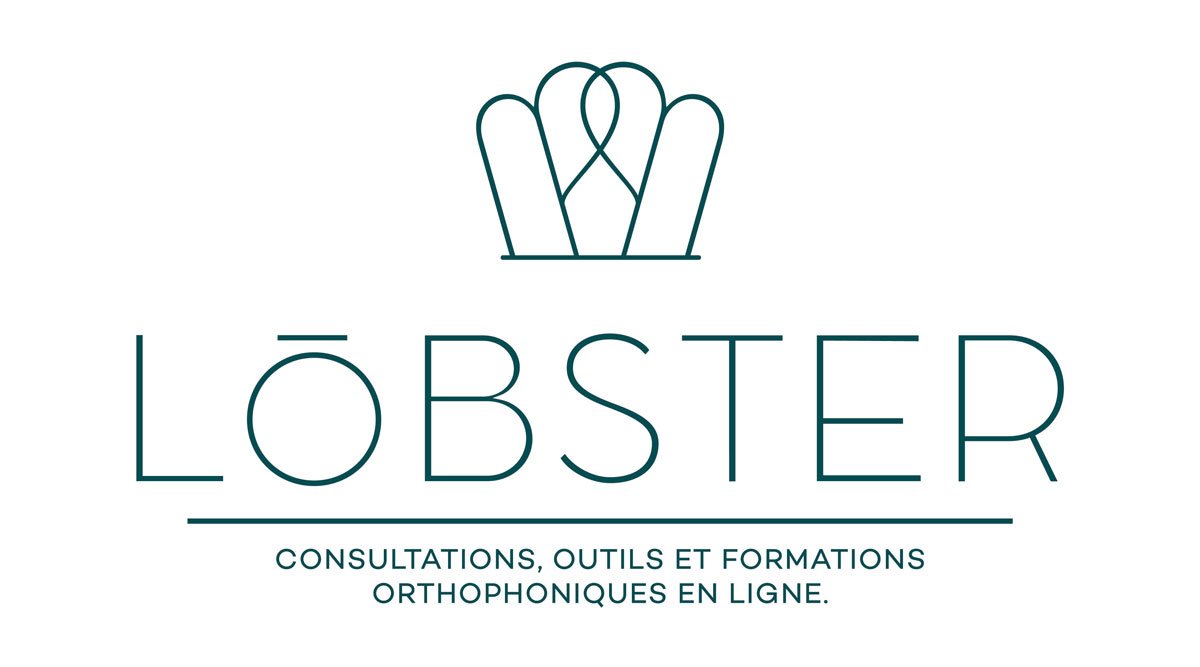L’expérience COVID 19 a contraint beaucoup d’entre nous à concilier des enfants (et un travail) à la maison ! Voici une compilation dans laquelle piocher pour travailler/éduquer/occuper le microcosme familial.
“Ça” s’appelle confinement, quarantaine, phase 3 etc. en fonction des pays. Mais “ça” est sans frontières quand il s’agit de faire face à la difficulté d’allier “Et si on en profitait pour passer du bon temps offert en famille” et “Au secours, comment je vais faire pour travailler/les occuper/gérer la fratrie sans dispute et ne pas imploser !!!”
Dans ma boîte à idées, il y a…
- Des ressources scolaires : Réseau canopé, Lumni, Maxicours, Pit&Pit
- Des applications pour l’apprentissage des langues : Duolingo, Holyowl
- De la lecture : Bayam, Playbac presse (mention spéciale le petit quotidien)
- Des émissions éducatives/vidéos : Passe-partout, Il était une fois la vie/l’Homme, Salut l’info (de France info et Astrapi), Petits curieux, 1 jour 1 question, C’est pas sorcier
- De la radio : Les ptits bateaux, Radio pomme d’api
- Des histoires à écouter : les délicieux albums Didier jeunesse, Une histoire et… Oli (France Inter)
- Des films pour enfants : Benshi, films-pour-enfants
- Des activités manuelles : pâte à modeler, pâte à sel, peinture gonflante, perles à repasser, aquarelle, mandala ou coloriage pat’patrouille et princesses disney (Oui c’est la vraie vie !)
- Du ménage participatif : 1 tout petit endroit 1 jour
- Du sport : séance de gym sur tapis, parcours de motricité, patinage sur chaussettes
- Très important : De la rêverie, de l’ennui, du rien, de l’oisiveté, du “t’es dans la lune ou quoi ?!”
Et encore des activités en vrac
Dans le domaine du “faire”, il y a encore :
- Les fameux albums photos en retard, tous ensemble
- Une visite de musée virtuelle : soit en histoires offertes par le Musée d’Orsay, soit en visitant les œuvre grâce à Google Art
- L’arbre généalogique et téléphoner aux grands parents pour récolter les informations biographiques
- Un reportage photo ou vidéo de la quarantaine ! Sa variante : écrire en famille le journal du confinement
Un jour, une activité
Des enfants (et un travail) à la maison, c’est en effet être exposé.e à une situation très difficile pour les enfants. Celle de constater votre “absence présence” (“mammmaaaaaaann !”)… Et puis 3 minutes 56 plus tard, ils s’ennuiiiiiiient… Votre activité professionnelle est donc devenue “théâtrale”, entendue comme : “décomposée en plusieurs actes” !
Alors voici pour vous soutenir une activité par jour de quarantaine !
Semaine 1
Lundi 16 mars 2020
Le spectacle de cirque. Chaque enfant prépare un tour, les enfants entre eux aussi. Il faut des accessoires, voire des costumes. Pourquoi pas un décor. Bref, vous avez 1h30 devant vous pour travailler !
Mardi 17 mars 2020
Le défilé de mode. Une astuce bien pratique pour trier ses vêtements 😉 ! Et oui, trouver ses déguisements, c’est refaire connaissance avec des vêtements improbables… Les moins bien assortis, les “pas prévus pour ça” (seule consigne : on n’abîme pas !). Ou choisir ceux qu’on préfère, ceux qu’on ne peut pas porter tous les jours (autre consigne : on range l’armoire si elle est vidée !!!). On se maquille, on se coiffe. Oui les garçons aussi, parce que la femme n’a pas l’apanage de l’esthétisme et que féminisme ne rime pas avec abolition de la beauté 😉 ! Pour les plus grands, on choisit même la musique. On écrit l’ordre de passage et on s’entraîne à défiler, à poser !
Mercredi 18 mars
Activité massage. Les enfants sont friands de contact mais vous commencez à être moins disponible pour eux. Le massage est une réponse calmante, apaisante et nourrissante… Vous trouverez plein de vidéos tuto sur la toile. Plein de livres existent aussi. On peut passer un temps à se masser entre nous, on peut imprimer une fiche tuto ou leur demander de dessiner les étapes du massage qu’ils veulent tester. On peut les superviser de loin en leur laissant expérimenter et inventer leur massage. Du moment qu’on respecte : la nature de l’enfant, sa sensibilité ; et les limites du toucher. C’est évident heureusement, mais le massage est également une occasion d’expliquer à l’enfant où on peut le toucher, et où son intimité commence. Valable entre enfants.
Jeudi 19 mars
Institut de beauté à domicile. Séance de coiffeur avec massage de la tête, manucure, masques de beauté faits maison, pédicure. On se chouchoute, on prend soin de soi et de l’autre.
Vendredi 20 mars
L’école. Les plus grands s’occupent des plus petits. Il s’agit de faire l’école à la maison, par les plus grands pour les puînés. Pour les plus jeunes ça fera “jeu de la maîtresse”, avec reprise des classeurs de maternelle comme support, pour les plus grands on sait que la meilleure façon d’apprendre c’est d’enseigner aux autres. Il s’agira donc d’expliquer les notions difficiles vues en classe aux plus jeunes, en rendant le contenu accessible. Et n’oublions pas qu’il y a le sport à l’école, la récré… Les arts plastiques !
Samedi 21 mars
The Voice ! Les enfant s’entraînent, choisissent leur.s morceau.x. La famille se retourne et c’est parti pour les auditions à l’aveugle !
Viennent ensuite les duo. Le tout avec un faux micro, des chorégraphies, bien sûr…
Dimanche 22 mars
Dimanche Konmari – les vêtements. Chaque dimanche, on s’y colle. Trier, ranger, se débarasser du trop plein… On pense solidaire : je donnerai à une association plutôt que d’empoussiérer mes armoires… Chacun le fait dans son coin pour ne pas être limité par un membre de la famille (“Tu veux jeter ça, tu es sûûûûûûr ???”). Et on commence, selon la méthode Konmari, par les vêtements. Allez, on y va, chacun y met du sien et on ne garde que ce qui va toujours, ce qu’on met toujours, ce qui nous fait toujours plaisir à porter. Le reste ? Solidarité, les associations caritatives ne manquent pas.
Semaine 2
Lundi 23 mars
Faire un exposé. Chaque enfant choisit, en fonction de son âge : un objet qu’il aime pour les tout-petits, une activité pour les petits, un thème pour les plus grands.On peut chercher dans les livres ou sur internet (attention à la règle des 3-6-9-12 : pas d’internet tout seul avant 9 ans) pour parler de l’origine, des usages dans le passé, des liens de cette objet/activité/thème avec la vie quotidienne de l’enfant, des motifs du choix etc. On prépare une fiche (les plus petits sont aidés par les plus grands) et quand tout est prêt, les enfants font leur exposé tour à tour.
Mardi 24 mars
Ecrire un télégramme. Ecrire un télégramme c’est se plonger dans l’histoire, c’est comprendre, au temps du confinement, la durée du temps il y a un siècle et demi. Parce qu’écrire un télégramme, c’est un peu d’imagination, et du codage en morse ! On écrit un télégramme en morse pour les grands-parents, et on le code en visio ce soir, webcam éteinte du côté des enfants, en ayant un œil sur ce que les grands-parents écrivent (et donc comprennent). Et si les grands-parents ont joué le jeu et qu’ils ont préparé un message pour les enfants, quelle surprise de les entendre faire des “bip” et des “biiiiiiip” puis de découvrir le message codé !
Mercredi 25 mars
Jardinage. On coupe une tranche du cœur de la tomate, on rince les pépins du poivron, on garde le noyau de l’avocat, on égraine un concombre, on sélectionne les plus belles graines de courgette. On place les graines dans du sopalin, on plante dans un pot de terre si on en a, dans plus de sopalin si on n’en n’a pas, on arrose, et on prend soin de sa plantation pour la voir sortir des racines puis percer une petite tête verte. Activité que les enfants peuvent faire seuls (couteau mis à part pour les plus petits).
Jeudi 26 mars
Ecriture d’un livre. Oui, rien que ça ! On prend des feuilles A4 (pas trop, hein ! Les enfants s’enflamment toujours au départ à vouloir écrire des titres, et puis en fait ça décourage d’avoir trop de pages… “à écrire”), on les plie, on les relie en faisant de la couture comme un vrai livre, on s’entraîne à faire des belles lettres pour le titre, on écrit l’histoire sur la page de droite et on l’illustre sur la page de gauche. Un vrai bijou à conserver précieusement 💙. Et mine de rien, on aura fait travailler la programmation (prévoir), la motricité fine (couture), le graphisme, l’orthographe (même si je vous décourage de vouloir corriger les fautes, ce n’est pas le but), l’art (dessin et production d’écrit). Surtout on aura travaillé sur l’imaginaire, le monde merveilleux de l’écrit, et on aura eu une jolie fenêtre sur leur vie intérieure !
Vendredi 27 mars
Théâtre de doigts. On s’inspire avec les textes de François Morel ici : https://www.lumni.fr/programme/manimo. Puis les enfants s’entraînent à créer des animaux avec leurs mains. On peut se peindre les doigts ou condamner une paire de chaussettes (extraite dimanche Konmari dernier !). Les enfants pensent une histoire. Et ce soir, c’est spectacle de doigts !
Samedi 28 mars
La cabane. Marre de connaître par cœur les pièces de la maison ou de l’appartement ?… On autorise, pour un jour, le grand chantier dans le salon ! Aujourd’hui, les enfants peuvent construire leur cabane à coup de draps, d’oreillers, de coussins, de chaises, de cordes, de pinces à linge… Tout est ok du moment qu’on n’abîme pas et qu’on ne se fait pas mal, évidemment. Cette cabane est pour les enfants une occasion de s’approprier l’espace autrement, de revisiter les lieux, de créer un univers à leur taille, rassurant (en ces temps d’inquiétude latente, ce n’est pas de trop…) et ludique. C’est aussi pour eux l’occasion de “voir” la place qu’ils occupent, la place qu’on leur laisse. Et puis à la fin de la journée on range. Parce que l’espace commun se partage. Et ça aussi, ça s’apprend (quitte à la refaire demain !).
Dimanche 29 mars :
Dimanche Konmari : les livres. Comme dimanche dernier, on y va joyeusement : on trie, on vide, on épure. Et ce deuxième jour, on s’attelle au tri des livres. Oui c’est dur de “se débarrasser” d’un livre. Encore une fois, on pense solidaire. Ce livre qu’on a eu tant de plaisir à lire à son enfant, une autre maman pourra le raconter. Donnez-vous un jocker : 3 livres témoin, ok. Mais tout le reste : on ne les lit plus ? Ce n’est plus de son âge ? Comparer le plaisir à avoir ce livre dans les mains au plaisir de ne plus avoir la sensation de boucler une grosse valise à chaque fois qu’il faut remettre un livre dans la bibliothèque. Alors laissez-les faire chacun leur tri… et consacrez-vous au vôtre !
Semaine 3
Lundi 30 mars
Relaxation. Et voilà, on commence à pouvoir dire que ça fait DES SEMAINES que nous sommes confinés (oui “deux” ça fait “des” !). Au départ, les enfants sont amusés. Et les parents sont pleins de bonne volonté. Mais voilà, l’ensemble évolue doucement mais sûrement vers un énervement latent. Alors l’activité d’aujourd’hui pour se dégager du temps de travail, c’est une relaxation guidée. Une vraie grande relaxation ! Avec une préférence pour une relaxation de boule d’amour. Cette pandémie nous réapprend dans les actes la valeur de la solidarité. Être en confinement signifie ne pas contaminer des personnes fragiles qui, elles, sont très en danger avec le virus. Alors une relaxation guidée de boule d’amour se pose là ! Et si vous lâchiez le travail pour la faire, vous aussi ?
Mardi 31 mars
Jeu de mime. On extrait des jeux des petits des cartes de dessins, ou on note sur des papiers pour les lecteurs pour avoir une pioche à faire deviner. Cette activité, au delà de donner naissance à de chouettes fous rires, est aussi une occasion d’enrichir le langage non-verbal, tellement précieux pour les enfants en peine avec le langage oral.
Mercredi 1er Avril : CQFD…
Jeudi 2 avril
Peter Pan artistique. La photo du dessin des ombres devient aussi virale que le COVID sur la toile : on place des objets du monde de l’enfant (figurines, bateau Playmobils….) ou du quotidien (plante, fourchette…) au soleil, et on dispose une feuille sous l’ombre de manière à pouvoir la décalquer. On propose ensuite aux enfants de découper des éléments de leur ombre pour en faire des collages à la Matisse, ou de les remplir de couleurs vives comme le Douanier Rousseau.
Vendredi 03 avril
Journée sans écran – festival de jeux de société. Entre l’école numérique, les visio avec la famille et la “nounou-télé”, le risque d’exposition aux écrans explose. 3ème semaine de confinement, 3ème semaine à risque. Alors aujourd’hui c’est une journée de sensibilisation. Le message est clairement exprimé aux enfants : “Attention, il faut veiller au temps d’écran”. Aujourd’hui, c’est une journée SANS AUCUN ECRAN. Pas de téléphone, pas d’ordinateur, pas de télé, pas de tablette. Pas d’écran. On troque le 2.0 en journée jeux de société. Les plus grands l’appelleront la “journée à l’ancienne” 😉 Mais quand on sait que les ados passent en moyenne 7h30 sur leur téléphone par jour, il y a de quoi lancer la réflexion ! Place aux Yams, dames, dobble, times’up, mémory, Dr Maboul, ce que vous avez, ce qui vous amuse : un festival de jeux de société !
Samedi 4 avril
Le Spectacle de danse. Beaucoup de tutos sont présents sur la toile. Mais évidemment, le plus beau des spectacles, c’est celui créé par vos enfants eux-mêmes. Objectif confiance en soi : je suis capable de danser ! Je peux faire ce que je veux. A distinguer des “il faut” bien danser, “il faut” que ce soit beau. Les enfants répètent leur spectacle, ils s’habillent de leur plus beau costume, se maquillent pour donner leur représentation. Et ce soir, on regarde un bout de ballet !
Dimanche 5 avril
Dimanche Konmari. Les jeux. On continue sur le même principe que les deux dernières semaines avec les jeux. Proposez aux enfants de mettre de côté les jeux auxquels ils ne jouent ET ne veulent plus jouer. Et demandez-leur de le faire seuls. Oui parce que c’est dur à réprimer le “Comment ça tu veux déjà te défaire de ce jouet que je t’ai offert à Noël passé, c’est-à-dire il y a autant de mois que de chiffres dans le prix ?!”… Pourtant, en mettant un veto régulièrement, on inhibe la possibilité de trier ses affaires. Alors on pense joie/plaisir vs ennui/désintérêt. Et on y va gaiement. Quand le confinement sera fini, on aura plaisir à faire une brocante et mesurer la valeur des choses en gérant le ratio cagnotte de vente – achat sur le brocante.
Semaine 4
Lundi 06 avril
Origami. Il y a un côté lent à l’origami. Un côté “par étapes”. Un petit côté confinement… Et puis de l’entraide, un côté “je vais t’expliquer”. Surtout, on peut se tromper et refaire. Déplier et replier. Se tromper encore, et recommencer encore. L’origami entre enfants, source de détente et de confiance, pour tous les âges, et pour une bonne heure de travail des parents !
Mardi 7 avril
Yoga. 4ème semaine, on rentre en phase d’habitude pour les adultes, de ras-le-bol pour les enfants, bien gentils et résilients jusqu’à présent. Alors ce jour, c’est yoga pour tous. Vous trouverez tout un tas de postures pour enfants à imprimer (on pense au temps d’écran, évitons les vidéos…). On sort les tapis de sol (ou les couettes pour les moins sportifs !). Et on s’essaie. Attention à l’excitation. Ce n’est pas un jeu de clownerie où celui qui tombe le 1er gagne le Nez d’Or… C’est un temps de concentration, de centration sur soi. On dirige son attention sur l’équilibre et le maintien de la posture. Et puis, qu’on se le dise, ça fait de jolies photos pour l’album du confinement !
Jeudi 8 avril
Le Bowling ! Cela fait des semaines que vous collectionnez les bouteilles en plastique de lait ? Parfait 😉 Dès que vous en avez 6, on les dispose vides (3 derrière, 2 au milieu et 1 devant), on prend une balle en plastique ou en mousse, et c’est parti pour le bowling dans le couloir ou le salon de l’appartement, la cour ou le jardin de ceux qui accèdent à l’extérieur. Pour les plus grands, on augmente le nombre de “quilles” jusqu’aux 10 quilles réglementaires… voire aux 20m de distance (quel appartement !). Exercice d’adresse et de concentration dans lequel finalement, celui qui s’énerve perd…
Vendredi 9 avril
Peinture avec les mains… ou les pieds ! Il y a l’école à la maison, il y a le calme à la maison, il y a se tenir. Et puis il y en a marre des pinceaux pour peindre alors allons-y gaiement ! On dispose de la gouache dans des assiettes et les enfants peuvent exploiter leur corps pour fabriquer des feuilles d’arbre avec leurs empreintes, un pingouin avec leurs pieds, un cygne avec leur main… Ou encore une fresque de la famille avec la taille des mains et des pieds pour témoigner de la place de chacun (cf webinaire sur la gestion de la fratrie !) : gardez-la, ce sera sans doute revu avec nostalgie comme une chouette toise horizontale dans quelques années.
Samedi 10 avril
Danse tes émotions ! Selon Niezsche : “Et que l’on estime perdue toute journée où l’on aura pas dansé au moins une fois.” (Ainsi parlait Zarathoustra), ce qui a participé à inspirer la talentueuse Nadia Vadori-Gauthier pour “Une minute de danse par jour“. Avec ou sans musique, sans volonté esthétique, mais purement dans la catharsis, on décharge, on défoule, on évacue, bref, on exprime. L’avantage de la danse, si l’on devait n’en citer qu’un, c’est que tous les mouvements sont permis. Alors place à l’expérimentation des possibles. Et si arrivez à vous rendre disponible, suivez, imitiez, copiez vos enfants, ils sont tellement plus libres que nous. Aujourd’hui, je danse mon ressenti !
Samedi 11 avril
Ecouter un conte musical. Se recentrer, écouter, rêver. Radio Classique nous offre un trésor : des histoires sur la musique de grands compositeurs classiques et contées magnifiquement par Elodie Fondacci. Vous vous souvenez sans doute de Pierre et le Loup dont les instruments représentent chaque personnage ? Ici, éloignez les enfants des écrans et laissez-les (re)découvrir Cendrillon, Le lac des Cygnes, Casse-Noisette, Les musiciens de Brême… Poésie et éveil musical, rêverie et évasion… Bonne écoute !
Dimanche 12 avril
Dimanche Konmari : Les chaussures et la vaisselle. Bon, certes, ça n’a rien à voir ! Mais peut-être que le tri des chaussures est facile pour les enfants qui trient déjà depuis 4 semaines, là où pour les adultes, celui de la vaisselle et des ustensiles de cuisine est moins évident ! C’est parce qu’on va jusqu’au bout que ça marche. Gardons en tête l’objectif : épuration !
Semaine 5
Lundi 13 avril
Cuisine en autonomie. Ce n’est pas parce que les parents que nous sommes sont désormais prétendants non seulement à un salaire de l’Education Nationale et à la délivrance du BAFA mais également à une étoile au Michelin que les enfants doivent parier sur les compétences culinaires des parents et à leurs bons services… Pour les plus jeunes, bien sûr, on se contentera d’un gâteau au yaourt (et d’un ménage complet de la cuisine). Mais pour les un peu plus grands, on proposera de confectionner intégralement le dîner. Associations de saveurs, propositions peu ordinaires et déséquilibre alimentaire sont, exceptionnellement, autorisés, du moment que ce sont les enfants qui sont en charge de la constitution du repas. Au-delà de l’avantage logistique du jour, c’est aussi une prise de conscience qui est proposée pour que les enfants accèdent un peu plus au partage des tâches. Bon appétit !
Mardi 14 avril
Le professeur de sport. Sur le modèle de “c’est toi qui fais l’école”, cette fois-ci les enfants vont créer leur cours de sport ! Au programme course chronométrée, pompes, challenge de corde à sauter, équilibre, dribble, pompes, chaise contre le mur… En réalité, ce ne sont pas les enfants qui vont manquer d’idées alors laissez les faire… et laissez-vous guider !
Mercredi 15 avril
La météo des émotions. Cette proposition est particulièrement valable pour les fratries. Il s’agit en effet de créer une roue des émotions. Ou bien le cocotier des émotions ! Mais encore le paysage des émotions ! Laissons simplement aux enfants le choix de leur créativité ! Pour cette activité, vous aurez juste besoin d’une flèche, d’un curseur ou d’une épingle pour désigner l’état émotionnel dans l’instant. C’est un jeu qui permet de :
- distinguer l’émotion (je ressens…) et le sentiment (j’éprouve…) ;
- différencier ressenti personnel (je me sens énervé, je me sens ennuyé, je me sens excité) et ressenti interpersonnel (je sens qu’il/elle m’énerve, je sens qu’il/elle m’ennuie, je sens qu’il/elle m’agace) ;
- comprendre ce qu’est un ressenti (à cette minute) et un ressentiment (issu du passé)…
La météo des émotions permettra donc non seulement à l’enfant d’exprimer ses émotions, mais également de prévenir ou guerre-rire (pas pu m’en empêcher !) les disputes dans la fratrie (cf Vidéo Web sur la gestion de la fratrie). A vos ciseaux, feutre, gouache, attaches anglaises, collage… et que ça sorte !
Jeudi 16 avril
Journée Claude Ponti ! Le site de l’école des loisirs propose une journée spéciale Claude Ponti avec tout un tas d’activités pour les enfants. Le concept est génial… Et dupliqué avec de nombreux auteurs : une journée avec Simon, une journée avec Ungerer… Place à la créativité !
Vendredi 17 avril
L’élastique. Bon. Certes, en appartement, mieux vaut être au rez-de-chaussée si on tient à ses relations de voisinage ! Pour les autres, on place l’élastique entre 2 chaises, et au besoin, on cherche des routines sur YouTube.
Motricité, sport, rigolade. Les voilà donc occupés pendant un petit moment !
Samedi 18 avril
Le spectacle de théâtre. Et oui bien sûr, nos enfants sont des génies de la création 😉 ! Entre jeux de semblant et scenarii avec les Playmo, leur capacité à inventer des histoires est sans limites ! Mais le spectacle de théâtre leur demandera tout de même un petit peu de temps pour organiser une histoire, la fixer, la suivre et la nourrir. Une fois le script créé, les répétitions commencent. Chacun son rôle, chacun son personnage. A défaut, on sollicite les peluches ou les animaux de la maison ! Puis vient l’heure du choix des costumes et du maquillage. Rideaux, 3 coups : silence ! Ils jouent !
Dimanche 19 avril
Dimanche Konmari : les objets de décoration et à valeur affective. C’est le dernier dimanche et le plus difficile. Le vieux doudou tout râpeux : on garde ! Mais par pitié, apprenez à vos enfants à ne pas devenir des adultes au “caleçon fétiche” 😉
Cet objet m’apporte de la joie ? Je le garde. J’ai juste de la fidélité pour ce collier de nouilles mais en vrai… Je le jette.
Courage ! Les étagères vides donnent autant de joie que celles qui prennent la poussière !
C’était le confinement 2020.
Ces idées vont maintenant nourrir les vacances scolaires, les mercredi après-midi, les “j’en ai pour 1 minute”.
Puissent-elles surtout vous aider à fabriquer des souvenirs riches et joyeux à vos enfants !
Ca vous a plu ? Partagez, diffusez !